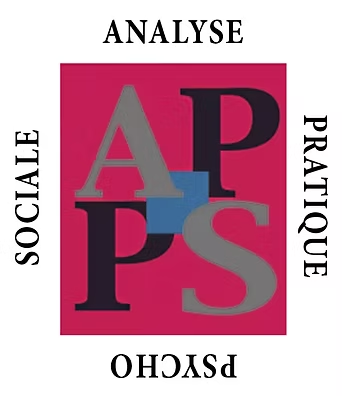Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Articles
-
Le matérialisme féministe à l’épreuve du genre et de la transitude : repenser l’oppression en termes de classes sexuelles

Le matérialisme féministe, héritier du marxisme, propose une lecture profondément politique de l’oppression des femmes. Mais à l’heure où les luttes féministes croisent les revendications trans, queer et antiracistes, que reste-t-il de ce cadre théorique ? Comment peut-il encore éclairer les nouvelles formes d’exploitation liées au genre ?
Le féminisme matérialiste : une théorie des classes sexuelles
Né dans le sillage du marxisme, le féminisme matérialiste, notamment porté par Christine Delphy ou Colette Guillaumin dans les années 70, considère que l’oppression des femmes repose sur une base matérielle : leur place spécifique dans les rapports économiques, notamment via le travail domestique gratuit, leur mise en dépendance économique, et leur assignation à la reproduction. Le patriarcat n’est pas un simple système culturel, mais un mode de production spécifique, parallèle et articulé au capitalisme. Il engendre une division de classes entre les hommes (classe dominante) et les femmes (classe exploitée).
Le sexe comme fait social, pas naturel
Le matérialisme féministe repose sur une thèse antinaturaliste : ce que nous appelons “sexe” est déjà traversé de représentations sociales. Le genre précède le sexe, qui est lui-même une construction idéologique. Loin d’être une donnée biologique neutre, le sexe est un produit d’un système de hiérarchisation des corps. Les catégories “homme” et “femme” ne sont donc pas naturelles, mais bien des classes sociales, dont l’appartenance détermine des positions d’exploitation ou de domination.
Transfeminisme matérialiste : vers une critique renouvelée du genre
Les mouvements trans ont contribué à réinterroger le féminisme matérialiste, parfois dans la tension. Des théoricien·nes trans matérialistes proposent une relecture radicale : la transidentité n’est pas un phénomène psychologique individuel, mais une expérience sociale structurée par l’exploitation, la précarité, et les violences systémiques. Le sexe est alors pensé comme appartenance de classe, et la transidentité comme un transfuge social : changer de sexe, c’est aussi changer de place dans la hiérarchie patriarcale. Cette mobilité est asymétrique : la “féminisation” d’un homme est davantage sanctionnée que la “masculinisation” d’une femme, révélant les rapports de pouvoir sous-jacents.
Obstacles à la reconnaissance des personnes trans dans les féminismes
Le féminisme queer a parfois déplacé la focale vers le langage et les identités individuelles, au détriment des rapports sociaux concrets. Parallèlement, un certain féminisme cisgenre (notamment les TERF) rejette la légitimité des femmes trans, au nom d’une “socialisation féminine” essentialisée. Ces discours entretiennent un climat de méfiance, d’exclusion, voire de paternalisme envers les femmes trans, souvent sollicitées non pas comme femmes, mais “en tant que trans”.
Inégalités et violences : les réalités matérielles des trajectoires trans
Les trajectoires trans sont traversées par des inégalités sociales profondes, structurées par le sexe, l’âge, la race, et la classe. Les personnes trans racisées cumulent les oppressions : difficultés d’accès à la santé, au logement, à l’emploi, aux droits civiques… L’absence de reconnaissance institutionnelle pousse à la précarité, l’économie souterraine, voire à la prostitution. La médicalisation du parcours trans renforce encore cette violence structurelle : les médecins imposent des stéréotypes de genre pour valider les transitions, notamment par le test de « vie réelle » excluant ceux et celles qui ne se conforment pas aux normes attendues.
Politiser les vécus, refuser l’essentialisation
Les expériences trans racisées ne doivent plus être considérées comme des objets d’étude, mais comme des sujets politiques. Elles doivent pouvoir parler pour elles-mêmes, hors des catégories occidentales, médicales ou académiques. L’autodétermination passe par le refus de l’universalisation du modèle “trans occidental” et par la reconnaissance de la pluralité des systèmes de genre, ancrés dans cultures non occidentales, en témoignent les hijras, two-spirits, kathoey entre autres, souvent réduits à des curiosités exotiques.
Résister dans les marges : entre solidarité politique et autodéfense
Là où les discours théoriques peinent à construire des ponts, des pratiques concrètes comme l’autodéfense féministe permettent de créer des espaces de solidarité inter-féminine, incluant toutes les femmes, cis et trans. La reconnaissance des violences vécues par les femmes trans, notamment dans le couple, la famille ou par les institutions, reste marginale, pourtant elles révèlent avec acuité les violences fondées sur le genre dans toute leur brutalité.
Vers un féminisme matérialiste renouvelé et inclusif
Le féminisme matérialiste a posé des bases fondamentales pour penser l’oppression des femmes en termes de rapport matériel et de classe sexuelle. Mais son avenir se joue dans sa capacité à intégrer les expériences trans et racisées sans les réduire ni les subsumer. La lutte féministe ne peut être qu’intersectionnelle, antiraciste, anticapitaliste et transinclusive. Sans cela, elle se condamne à reproduire ce qu’elle prétend abolir.
Alison PARDIEU
Tristan Marcel : Accompagner les Mineurs Non Accompagnés

L’avantage d’un acronyme, c’est qu’il permet d’effacer le sujet derrière le signifiant. Ainsi, le discours médiatico-politique envisage le MNA, mineur non accompagné, comme l’insigne désincarné d’une problématique sociétale, voire un simple indicateur statistique à minorer. En bâillonnant confortablement toute empathie pour ces jeunes êtres humains marqués par des parcours migratoires effroyables, l’acronyme désubjectivant protège le locuteur lui-même de la portée traumatogène de ces récits de vie.
Cette désubjectivation dans le langage s’accompagne concrètement d’une injonction narrative tout aussi déshumanisante. En effet, les logiques administratives imposent aux mineurs non accompagnés une douloureuse épreuve : se raconter, se dévoiler, exhiber ses blessures pour espérer obtenir une protection pourtant due. Cette exigence, sous le regard suspicieux d’institutions dubitatives, les confronte à une menace permanente d’éclatement narratif et à une perte d’identité.
Dès lors, les outils APPS, qui soutiennent la restauration de l’humain dans toute rencontre thérapeutique, aident à penser l’accompagnement de ces adolescents.
Transfert social : une dépeaussession du récit de soi
L’injonction narrative impose aux migrants mineurs et isolés un impératif cruel : raconter une histoire dont la légitimité se mesure à l’aune de sa souffrance explicite et à sa cohérence avec les attentes institutionnelles. Comme le souligne Noémie Paté, ces jeunes doivent exprimer leurs souffrances sans tomber dans la dramatisation, se présenter de manière spontanée tout en livrant des récits objectivables, un exercice qui les expose à un « éclatement narratif » profond (Paté, 2022). Or cette mise en récit forcée advient lors d’une période de grande fragilité aux multiples facteurs : parcours migratoire jalonné de violences multiples, remaniement intense du vécu pré-migratoire, précarité de la situation actuelle, angoisses vis-à-vis d’un avenir incertain, bouleversements induits par le processus adolescent…
Il n’est donc pas rare que ces jeunes rencontrent la plus grande des difficultés à verbaliser ce qu’ils vivent et ont vécu et c’est pourtant à ce moment de leur parcours que leur est imposée une performance du récit de soi. En outre, le dispositif administratif, qui « conditionne l’accès à la protection par la mise à l’épreuve du corps et du récit biographique » (Paté, 2024) s’inscrit dans un « contexte où le soupçon précède l’écoute » (Paté, 2022). Comment, dès lors – quand « les yeux seuls sont encore capables de pousser un cri », comme l’écrit René Char (1962) – le jeune peut-il produire le récit de ce qui ne fait pas encore sens pour lui ? Les logiques administratives le soumettent à une douloureuse poussée contraire : performer son histoire et son identité selon les attentes sociales tout en restant authentique.
Cette mécanique perverse impose donc à ces adolescents un transfert social délétère : ils doivent en effet produire un discours conformiste, souvent éloigné de leur vérité profonde, à laquelle ils n’ont pas toujours accès. L’injonction narrative engendre une dépossession intime du récit de soi, qui vaut pour dépeaussession, réduisant l’identité des « MNA » aux seules attentes et représentations des évaluateurs. Les voilà s’aliénant leur propre histoire afin de correspondre à une image préfabriquée d’enfant vulnérable et crédible selon des critères flous et préconçus.
Enjeux thérapeutiques et boussoles APPS
Face à cette violence institutionnelle, l’accompagnement thérapeutique se doit de proposer un espace exempt de l’impératif administratif, un « espace-refuge » où il sera question de restaurer et de protéger l’identité narrative des mineurs non accompagnés, dans une dynamique de co-création thérapeutique : « Tisser à nouveau des relations sécurisantes avec des adultes permet à ces sujets, qui ont vu leur rapport à l’autre bouleversé, par les violences qu’ils ont subies ou dont ils ont été témoins, de retrouver une place d’enfant et de parler d’eux » (Feldman, Lauer, 2022). Autrement dit, la rencontre clinique cherchera à accompagner ces adolescents dans une historicisation (Aulagnier, 1989) ou ce que Georges Politzer appelait le travail du drame, qui les aidera à redonner du sens à leur histoire, réintégrant les parties traumatisées ou dissociées en un tout cohérent et authentiquement leur.
Ce travail s’accompagne d’un repérage de « la mise en anneaux des valeurs », préconisé par le docteur Hervé Hubert, qui rappelle justement que l’identité se construit aussi à partir du transfert de valeurs : ces valeurs – de mots, d’images et de ressentis corporels – sont enlacées les unes avec les autres dans un système dont il s’agit de préserver l’accord, la congruence et l’équilibre.
En outre, l’échange authentique offre un éclairage nouveau, non seulement sur l’histoire individuelle mais aussi sur la violence sociale et institutionnelle que subissent ces mineurs – et dans laquelle le psychologue est malgré tout intriqué. Il s’agit à la fois de soutenir la mise en récit de leur histoire singulière et l’inscription de leur parcours dans une dimension collective plus large, reflet de violences politiques et économiques contemporaines (Balibar, 2018).
A travers la rencontre d’un « tu à qui parler », pour reprendre l’expression de Paul Celan (1958), le jeune recouvre progressivement son identité narrative (Ricœur, 1991), essentielle à la restauration de son sentiment de permanence. Quelle que soit l’approche thérapeutique, il s’agit toujours d’aider le patient à se vivre sujet de sa vie.
L’impératif d’une analyse des éprouvés contre-transférentiels
La rencontre avec les mineurs non accompagnés réactive chez le clinicien des angoisses archaïques d’abandon, de séparation voire d’effondrement, marquées par une identification aux récits traumatiques et à l’errance du jeune patient. La clinique avec ces adolescents, souvent livrés à eux-mêmes dans des parcours jalonnés de violences multiples, instaure une rencontre effroyable avec un « réel non transformé qui fait effraction dans le psychisme et qui y demeure comme un corps étranger » (El Husseini, 2016). Face à ces récits, le clinicien peut éprouver des sentiments d’horreur, d’impuissance ou de culpabilité, voire de sidération, signes de la mise en œuvre d’un contre-transfert intense. Ces affects sont en outre imprégnés de la logique de l’urgence, du soupçon et de représentations culturelles complexes, révélant ainsi la nécessité d’une vigilance réflexive accrue. En effet, dans l’insu du faire du thérapeute, ces éprouvés risquent d’entraver la mise en place du lien thérapeutique, étroitement articulé avec une défense face à un réel traumatogène que l’on préfère ne pas voir.
Pour autant, ces ressentis contre-transférentiels ne doivent être ni chassés ni déniés. Au contraire, leur analyse offre une voie privilégiée pour appréhender le trauma migratoire. Par un travail introspectif, le clinicien peut déceler comment ses propres réactions émotionnelles renseignent sur le vécu profond de ces adolescents qui n’ont pas toujours accès à la verbalisation.
Comme dans toute clinique et quelle que soit son orientation, le thérapeute doit donc s’observer autant qu’il observe, afin d’éviter l’écueil de la « rhétorique du parasitisme » (Paté, 2024) et restaurer une dynamique avant tout humaine où empathie et authenticité cohabitent sans clivage ni projection délétère. C’est à cette condition qu’il pourra offrir un espace sécurisé, respectueux du silence et des résistances de ces adolescents, suivant une temporalité psychique propre à chacun.
En guise de conclusion, rappelons l’étymologie du verbe accompagner : se tourner vers (ad-) celui avec qui (cum) je partage mon pain (panis). Le Mineur Non Accompagné est celui duquel le monde entier s’est détourné, celui avec qui le monde ne partage plus, celui à qui toute compagnie est refusée. L’accompagnement de ces adolescents doit donc restaurer le mouvement vers et la dynamique avec, matrice de toute relation entre humains. Il s’inscrit dans un travail de réhumanisation et de résistance aux effets nocifs du transfert social.
L’approche APPS, dans ce contexte, ne constitue pas seulement un soutien thérapeutique, mais bien une nécessité clinique pour permettre à ces jeunes de se réapproprier pleinement leur histoire, de restaurer leur identité narrative, profondément mise à mal par les exigences paradoxales d’une société à la fois accueillante et suspicieuse. Plus largement, se dessine l’enjeu collectif de la construction d’une éthique de l’hospitalité clinique – en se rappelant avec Mahmoud Darwich (2003) que « nous sommes tous étrangers sur cette Terre ».
Tristan Marcel
Professeur agrégé de Lettres Modernes
Psychologue clinicien – psychothérapeute
Bibliographie :
- Aulagnier, P. (1989). Se construire un passé. Journal de la psychanalyse de l’enfant, 7(2), 191-220.
- Balibar, E. (2018). Pour un droit international de l’hospitalité. Le Monde, 16 août 2018.
- Celan, P. (1958). Allocution prononcée lors de la réception du prix de littérature de la Ville libre hanséatique de Brême. Dans Le Méridien & autres proses. Seuil (2002).
- Char, R. (1962). Fureur et mystère. Gallimard.
- Darwich, M. (2003). Comme des fleurs d’amandier ou plus loin (Elias Sambar, trad.). Actes Sud.
- El Husseini, M. (2016). Exploration du contre-transfert dans la clinique du trauma : une étude qualitative. Université Sorbonne Paris Cité.
- Lauer, M. et Feldman, M. (2022). Quand le manque de protection des mineurs migrants redessine les contours de l’accueil – Étude d’un dispositif de familles accueillantes bénévoles. Dialogue, 236(2), 49-63. https://doi.org/10.3917/dia.236.0049.
- Paté, N. (2021). Les processus discriminatoires au cœur des pratiques d’évaluation de la minorité et de l’isolement des mineurs non accompagnés. Hommes & Migrations, 1333(2), 39-46. https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.12563.
- Paté, N. (2022). Les effets de l’injonction narrative sur les mineurs non accompagnés, entre résistances et dépendances. Psychologie Clinique, 53(1), 124-135. https://doi.org/10.1051/psyc/202253124.
- Paté, N. (2024). La mise à l’épreuve des récits des MNA comme condition à l’accès à la protection. Colloque annuel, Barreau de Marseille, Février 2024, Marseille, France.
- Ricoeur, P. (1991). L’identité narrative. Revue des sciences humaines, 95/221, 35-47.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
En quoi la neuropsychologie d’Alexandre Luria peut être rapprochée du savoir psychanalytique?
Préambule de Maria Karzanova et Hervé Hubert:
Nous publions cet article écrit en 2014. Nous avons bien sûr évolué depuis cette date dans nos rapports à l’histoire et aux théories psychiques et nous n’écririons pas exactement le même texte aujourd’hui, la force de l’enseignement de Luria l’a simplement emporté.

En quoi la neuropsychologie d’Alexandre Luria peut être rapprochée du savoir psychanalytique?
Aujourd’hui les travaux d’Alexandre Luria (1902-1977), psychologue russe, sont reconnus dans le monde entier pour leurs valeurs scientifique et esthétique. C’est grâce à lui que la neuropsychologie d’aujourd’hui a vu le jour.
Ayant trouvé un abri dans la discipline des neurosciences quelque années après la mort de Vygotski (1896-1934), il est devenu un savant renommé de l’anatomie et de la physiologie du cerveau humain. Ses travaux ont fondé un nouveau domaine qui est la neuropsychologie. Dans cette perspective, le cerveau est perçu comme un système strictement hiérarchique. Cette branche dominante dans le monde scientifique s’intègre dans le discours scientifique qui met au centre l’organisme comme système.
Un fondateur divisé dans son rapport au savoir
Nous souhaitons mettre en avant dans le débat entre neuropsychologie et psychanalyse, le fait que Luria lui-même, fondateur de la neuropsychologie, a occupé une position que l’on peut dire « en marge » vis-à-vis de l’objet de sa création.
Ainsi qu’il l’écrivait dans sa correspondance avec un grand neurologue du monde anglo-saxon, Oliver Sacks, Luria se sentait contraint de produire deux sortes d’ouvrages : des ouvrages systémiques, nanométriques, d’une part, comme par exemple « Les fonctions corticales supérieures de l’homme », et d’autre part, des ouvrages où il étudiait l’aspect romantique et idiographique de la science, aspect ignoré par les autres scientifiques de son époque.
Luria pensait que s’il n’y a que l’aspect scientifique, systémique du fait humain qui est étudié, il est facile de passer à côté de phénomènes cliniques tout à fait essentiels, sans s’en rendre compte.
Dans ses deux essais dits « romantiques » 1, l’analyse porte précisément sur ce qui est rejeté par d’autres auteurs, à savoir ce qu’il se passe sur l’autre scène, sous le masque du système « mémoire – perception – attention – sensation »
L’intérêt du travail de Luria est donc de proposer une analyse différente des auteurs classiques de son époque qui partent d’une conception du savoir où le trou en tant qu’organisateur de ce savoir est rejeté et rate quelque chose d’essentiel.
Si nous faisons référence aux cas cliniques qu’il décrit, quel est le mécanisme qui explique que l’homme qui a tout perdu, y compris la mémoire, et dont le monde vole en éclats, retrouve l’élan de la vie et se reconstruit en tant que sujet de son histoire?
De même qu’elle est l’explication du fait que l’homme qui possède une mémoire prodigieuse et extraordinaire, perde ses repères dans la réalité et plonge dans une passivité rêveuse ?
A ces questions, Luria répond: « Nous ne savons pas ».
Il y a quelque chose dans l’être humain qui ne peut être réduit au système « mémoire – perception – attention – sensation ».
Il y a un trou dans ce savoir.
La neuropsychologie classique et le discours universitaire
Il est à noter que la théorie de la neuropsychologie qui naît en Russie Soviétique est, au début, la science de l’hémisphère gauche.
Luria lui-même et ses collaborateurs les plus proches se sont focalisés sur les études des syndromes de l’hémisphère gauche qui peuvent effectivement être décrits en termes de système.
Dans son rapport au langage, l’hémisphère gauche, même anatomiquement, est mieux structuré que l’hémisphère droit où les limites entre les différentes zones sont moins nettes. Les syndromes de l’hémisphère droit sont moins connus, bien qu’ils soient presqu’aussi fréquents. Seul, le ” syndrome de la négligence latérale gauche ” a attiré l’attention des chercheurs.
Les syndromes dus à une lésion dans l’hémisphère droit produisent des phénomènes angoissants des plus étranges qui ne peuvent être décrits qu’en termes d’inquiétante étrangeté.
C’est le corps lui-même dans son sentiment d’être qui est atteint.
Certains auteurs, comme Pötzl, Head, Sacks, etc., décrivent des phénomènes qui impressionnent par leur caractère invraisemblable, parfois même comique: Les sensations d’avoir une jambe de bois, la partie gauche du corps amputée, d’être réduit à être uniquement une tête sur des épaules et ainsi de suite, appartiennent aux syndromes de l’hémisphère droit.
Certaines sensations sont tellement étranges qu’il est quasiment impossible de les faire passer par la parole.
Il arrivait souvent dans l’histoire de la médecine, même relativement récente, d’hospitaliser en psychiatrie les patients présentant de tels symptômes tellement ces sensations ressemblent au morcèlement du corps dans la schizophrénie.
Comme mentionné plus haut, les recherches qui ont été faites au sein de l’école russe de la neuropsychologie classique portent sur l’hémisphère gauche.
Parmi les recherches effectuées autour de l’hémisphère droit, il y a uniquement l’étude faite par Leontiev (1903-1979) et Zaporozhets (1905-1981) qui peut être mentionnée.
Cette étude relate les expériences de deux cents soldats blessés au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Même si la phénoménologie de cette étude est passionnante, l’analyse est formulée en termes de système.
La subjectivité du vécu réel de l’altérité du moi corporel est déniée.
La pensée mécanique, présente dans ce travail, traverse toute la théorie de la neuropsychologie classique.
C’est ici que l’apport du psychanalyste Jacques Lacan peut nous éclairer quant à la place de la pensée mécaniste systémique.
Dans son séminaire « L’envers de la psychanalyse » il construit en effet sa théorie des quatre discours : discours du maître, discours universitaire, discours de l’hystérique, discours psychanalytique.
Il ne nous parait pas sans importance que la neuropsychologie classique qui se base sur le système fonctionnel où tout élément a sa place, ai vu sa naissance en Russie Soviétique.
La critique essentielle que Lacan émet au sujet de l’Union Soviétique est l’universalité du discours de l’Université.
Voici ce qu’il dit à ce propos dans le Séminaire « L’envers de la psychanalyse »: « La configuration des ouvriers paysans a tout de même abouti à une forme de société où c’est justement l’Université qui a le manche. Car ce qui règne dans ce qu’on appelle communément l’Union des républiques socialistes soviétiques, c’est l’Université »2.
Ce n’est pas le discours du maître qui est mis en avant mais le discours universitaire qui a le savoir en position d’agent de production, qui commande la production.
L’être est réduit au savoir et explique la bureaucratisation.
La notion de Vérité qui est à percevoir justement en tant que trou dans le savoir, est à voiler, et dans le discours universitaire le Maître vient exactement à cette place voilée en rapport avec la position de commande: le Savoir.
Lacan fait valoir la division du sujet entre le savoir et la vérité qui introduit cette autre dimension pour l’être parlant que celle du savoir 3.
Le concept de trou est fondamental en sa qualité de moteur tout autant pour le collectif que l’individuel.
C’est dans ce trou que se place le discours psychanalytique avec cette dimension de supposition en tant qu’elle attribue une signification de jouissance à un autre.
C’est à travers l’expérience psychanalytique que l’existence de ce trou, cette place vide, se dévoile.
Le savoir universel supprime justement le trou où se place le sujet supposé savoir, le pivot dans le discours analytique.
De ce point de vue, la neuropsychologie classique en tant qu’elle est une science systémique mettant au centre l’ensemble des fonctions « mémoire – perception – attention – sensation », peut être considérée comme le symptôme du monde moderne, le discours hérité du concept hégélien de savoir absolu.
Le rapport de Luria à l’œuvre freudienne
Ce qui est intéressant de souligner est le fait que le fondateur de cette branche du savoir scientifique, Alexandre Luria, est étranger lui-même vis-à-vis de l’objet de sa création et ouvre une brèche dans le système.
Marqué d’emblée par la pensée freudienne, il n’a jamais renoncé à cette influence comme on aurait pu le croire.
Il suffit d’examiner de plus près sa théorie, les trois blocs du cerveau, sommet de la pensée scientifique lurienne, pour percevoir une parenté avec la deuxième topique de Freud : le Ça, le Moi, le Sur-Moi.
En effet, le premier bloc, énergétique, la source inépuisable et le médiateur de l’énergie se rapproche du Ça freudien, le deuxième bloc, dit de perception et d’analyse de l’information, renvoie à l’instance du Moi, enfin le troisième bloc, de programmation et de contrôle, fait penser au Sur-Moi.
Au début de sa carrière professionnelle, Luria avait déjà l’ambition de découvrir une nouvelle psychologie qui pourrait recouvrir l’approche idiographique et nanométrique. Cela l’a poussé à rejoindre Vygotski dans la quête d’une nouvelle science.
Réfugié dans les neurosciences après la mort de ce dernier, il est parti d’un discours purement scientifique et systémique pour arriver, vers la fin de sa vie, à l’objet fantasmé au début.
La correspondance que Luria entretenait avec Oliver Sacks, et dont celui-ci parle dans son livre « Sur une jambe », fait penser que la neuropsychologie classique était un simple outil dans sa quête, ce qui l’animait profondément étant logé ailleurs.
Les deux « Essais romantiques » qu’il a écrits dans les dernières années, ne peuvent-ils être considérés comme l’objet recherché par Luria?
Dans le dernier chapitre de son autobiographie scientifique, Luria parle de quelque chose de significatif dans la pensée qui l’animait tout au long de sa vie, à savoir la division, qui nous parait symptomatique, entre la science classique et la science « romantique ».
Cette division hérite d’une division plus ancienne entre le nanométrique et l’idiographique. La science classique est destinée à catégoriser les éléments et élaborer les concepts abstraits ce qui produit un savoir universel.
Cependant, dit Luria, dans la science classique il y a quelque chose de vivant qui disparaît. Au sein du savoir absolu qui est le produit de la science hérité de Hegel, le singulier, le concret n’a pas de place.
Le singulier fait trou dans le savoir universel, ce qui a pour conséquence le fait que ce singulier est le plus souvent rejeté.
Pendant tout son parcours scientifique, Luria réfléchissait à comment ne pas perdre de bases scientifiques tout en préservant le « romantisme » de la science: « Grise est la théorie, mais toujours vert est l’arbre de vie » 4.
Le terme « romantique », Luria s’en sert pour désigner l’objet qui l’attire, qui n’est pas le même que celui de la science classique.
Il dit dans son autobiographie: « Mon approche a été à la fois classique et romantique; mais il m’est arrivé dans ma vie de me basculer vers la science romantique » 5.
Tout en appartenant à l’école classique, il est le premier dans l’histoire de l’école russe à présenter l’étude d’un cas clinique singulier.
Au début de « La prodigieuse mémoire » il écrit ceci : « L’auteur espère que les psychologues qui l’auront lu voudront de leur côté découvrir et décrire d’autres syndromes psychologiques et analyser les traits caractéristiques qui apparaissent à la suite du développement particulier de la sensibilité ou de l’imagination, de l’esprit d’observation ou de la pensée abstraite, ou encore de l’effort de volonté dans la poursuite d’une idée. Ce serait le début d’une psychologie concrète qui n’aurait pas perdu pour autant son côté scientifique » 6.
Ses deux cas cliniques, « La prodigieuse mémoire » et « L’homme dont le monde vole en éclats » sont écrits dans la dernière décennie de sa vie, en 1968 et 1971.
Ce retour vers l’étude d’un cas singulier se démarque du savoir universel: ces deux hommes ont une fonction psychique qui ne s’inscrit pas dans les normes scientifiques. Cela fait une énigme pour la science classique, et c’est là que le côté « romantique » de Luria se manifeste. Luria revient vers la fin à la clinique concrète, singulière, ce qui relève, sans doute, d’un héritage freudien. On se souvient qu’il avait commencé son travail scientifique par l’étude des cas cliniques de Freud.
Le retour de Luria à Freud a contribué à l’invention d’un nouveau domaine scientifique qui est la neuro-psychanalyse.
Développé par Oliver Sacks et prononcé par Mark Solms, ce courant est né d’un rapport particulier que Luria entretenait avec l’œuvre freudienne.
Le cas de « l’homme dont le monde vole en éclats »
Le cas de « l’homme dont le monde vole en éclats » est non seulement l’histoire d’un patient de Luria, mais aussi l’histoire d’un rapport transférentiel, ce qui en fait un cas intéressant à reprendre. Luria n’est pas l’auteur de ce livre à proprement parler. Il commente ce qui a été écrit par Zassetski, son patient. Zassetski a été gravement blessé en 1943 par des éclats d’obus.
Cette blessure a endommagé la région pariéto- occipitale du cerveau du patient. C’est « l’histoire d’une balle qui a pénétré dans le crâne d’un homme, touché son cerveau, et fait voler un univers en éclats, le laissant irrémédiablement disloqué » 7.
En utilisant cette belle métaphore, Luria fait d’emblée un pont entre l’univers médical, le cerveau, et la réalité du sujet.
La zone atteinte chez ce patient est le deuxième bloc du cerveau, indique Luria. Ce bloc se situe dans les parties postérieures des deux hémisphères.
Son rôle principal est de recevoir, traiter et conserver les informations qui parviennent du monde extérieur à l’individu.
A l’intérieur de ce bloc, une région très importante est la région pariéto- occipitale, dite associative.
Elle se trouve en profondeur sur le croisement des zones occipitale, pariétale et temporale. Elle est donc responsable des synthèses visuelles, auditives, spatiales.
Elle garantit les relations complexes synthétiques entre les sensations élémentaires qui proviennent de différentes modalités.
La vision de l’individu reste relativement indemne, il continue à percevoir les objets séparément, il peut aussi percevoir les objets au toucher, entendre les sons, un discours. Mais une capacité très importante est atteinte : il ne peut rassembler les impressions en un tout.
Le sujet commence à vivre dans un univers éclaté, il continue à sentir son bras, sa jambe, mais quelle jambe, droite ou gauche ?
Il est aussi incapable de positionner les parties du corps correctement.
Zassetski perçoit sa jambe au-dessus du bras, la tête est d’une taille immense par rapport au reste du corps, il n’a plus accès à la signification des sensations cénesthésiques correspondant au besoin d’aller aux toilettes.
La même chose se manifeste au niveau du langage.
A titre d’exemple, les deux phrases, « le frère du père » et « le père du frère » ne sont pas distinguées par le patient.
Le patient ne comprend plus les catégories « au-dessus – au-dessous », « plus – moins ». Les objets ne sont plus reliés sémantiquement.
Les relations sémantiques sont atteintes.
Chez ce patient le trouble du langage, l’aphasie, touche à la fois les liens de contiguïté, de la métonymie, ainsi que ceux de la métaphore.
La structure d’une proposition est défectueuse du fait que les relations entre les éléments sont perdues.
« Lorsqu’il écoute son interlocuteur ou le contenu d’une émission de radio, en s’efforçant de comprendre le sens d’un récit dans son intégralité, Zassetski se trouve face à un écran de mots séparés, non reliés les uns avec les autres, fractionnés, indéchiffrable. » 8.
En même temps il évoque à plusieurs reprises sa difficulté d’associer un mot à une chose. A titre d’exemple, il voit un chat et il sait de quel animal il s’agit, mais il doit faire un effort pour trouver le mot « chat ». Il y a donc une certaine coupure entre le signifiant et le signifié qui produit une difficulté pour trouver ou extraire un mot.
Cela démontre une difficulté langagière d’établir une métaphore.
Après la blessure, le patient de Luria va jusqu’à éprouver l’aliénation des mots.
Que ce soit de l’ordre de l’écrit ou de la parole, ils sont vécus comme provenant d’une langue étrangère.
Pour parler de ce genre des troubles, Luria introduit le terme “d’aphasie optico-mnéstique” : « Toute lettre m’est étrangère et inconnue, je me contente de la regarder, j’ai l’impression d’avoir affaire à des lettres étrangères, je regarde le nom du journal, il est écrit en gros caractères et me paraît familier, mais ce n’est cependant pas du russe » 9.
Impressionnante est la façon de comment Zassetski vit son corps.
Tout d’abord il a ce qu’on appelle en neurologie le phénomène de la ” négligence spatiale unilatérale “: Le patient ignore ce qui est du côté droit de son corps.
« Plus tard je reviens à moi, je regarde du côté droit, et je constate avec effroi que la moitié de mon corps a disparu, je me demande non sans frayeur où sont passés mon bras et ma jambe droits et toute la moitié droite de mon corps, je remue la main, les doigts de la main gauche, je la sens, je la touche, mais je ne vois pas les doigts de ma main droite, je ne les sens même pas, l’inquiétude m’étouffe » 10, dit Zassetski.
En même temps le patient a parfois l’impression que les parties de son corps se sont modifiées, qu’elles ne sont plus à leur place.
Il lui arrive aussi de ne plus savoir que faire d’une partie du corps.
Zassetski donne un exemple qu’il trouve humoristique: Il a oublié comment aller aux toilettes.
Ainsi, en lisant ce récit, on peut conclure que le corps du patient ne correspond plus au corps du stade du miroir qui fait unité : les parties du corps partent chacune dans leur sens, l’ordre qui s’organise selon lequel chaque partie a sa place déterminée fait défaut.
Les descriptions données par le patient font penser à l’inquiétante étrangeté de Freud. Ce qui est angoissant actuellement – unheimlich – ne l’était pas, cela était un phénomène familier – heimlich.
Ce n’est qu’après-coup que cela devient inquiétant.
Dans la vie de l’être humain, avant le stade du miroir, le corps est vécu en tant que morcelé, non unifié par l’image.
Les sensations fragmentées sont perçues comme venant à la fois de l’extérieur et de l’intérieur.
Chaque être parlant en tant que prématuré passe par là.
Une nouvelle confrontation au morcellement corporel, notamment dans une maladie neurologique, se manifeste souvent comme inquiétante et étrange.
Le signifiant que Zassetski trouve pour symboliser cette expérience corporelle angoissante est : « dérangement du corps » 11.
En russe, le signifiant utilisé par le patient peut avoir plusieurs significations. Hormis le « dérangement », on peut parler aussi de « l’embarras » et d’une « perplexité ».
Zassetski, depuis sa blessure, est sujet à de nombreuses pertes.
Un des derniers chapitres du livre s’intitule « J’ai perdu tout mon savoir ».
Il ne met pas au centre de sa souffrance psychique les dérangements du corps, de l’espace, les phénomènes visuels.
Ce qui le fait le plus souffrir concerne ce qui se passe au niveau du signifiant.
Il nomme sa déficience principale : « la perte du discours de la mémoire » 12.
Il est sujet à une amnésie assez massive.
Les premiers jours après le traumatisme il ne peut se souvenir quasiment de rien, ni son nom, ni les noms de ses proches.
Au fur et à mesure les images commencent à venir, mais les images fragmentées disparaissaient aussitôt.
En même temps, il ne retient quasiment plus rien, dès qu’il fait un effort il commence à avoir mal au crâne, ce qui l’oblige à abandonner ses efforts: Il se trouve donc coupé du savoir qu’il possédait dans le passé et de toute possibilité de se le réapproprier: « Rien ne subsiste dans ma mémoire, même quand il s’agit de lire, au bout du troisième mot tout s’évapore » 13, dit Zassetski, « Il m’arrive même d’oublier les parties de mon corps » 14, ajoute-t-il.
Ainsi, le nom qu’il se donne est « aphasique mental » 15.
Les cours spécialisés lui permettent de réapprendre l’alphabet, mais la spécificité de son traumatisme crânien fait que la lecture reste quasiment impossible pour lui: il voit trois lettres à la fois, et pendant qu’il cherchait les lettres suivantes, il oubliait déjà les précédentes : « Quand j’essaie de lire un livre, je ne peux voir que trois caractères à la fois. J’oubliais souvent, avant de lire toutes les lettres d’un mot, le mot lui-même, et j’étais dans la nécessité de relire les lettres du mot pour le comprendre.
Il m’arrivait fréquemment de lire un mot sans en comprendre le sens, uniquement pour le lire.
Quand je veux comprendre le sens, il faut également attendre un laps de temps nécessaire à sa compréhension.
Une fois que j’ai lu le mot et en ai compris le sens, je peux avancer, je lis un second mot, j’en comprends le sens, j’en lis un troisième, j’en saisis le sens, mais, à ce moment-là, je ne me rappelle plus précisément le sens du premier mot et parfois du deuxième, je les ai déjà oubliés et je suis dans l’incapacité de m’en souvenir malgré toute ma volonté et tous mes efforts » 16.
La « découverte décisive » est liée à l’écriture.
Au tout début c’est aussi difficile que la lecture: il doit réfléchir à chaque lettre, à son image graphique.
Or, chez Zassetski la lésion a détruit les aires visuelles et sensori-spatiales du cortex, quand il réfléchit à l’image d’une lettre, la tâche de l’écriture devient impossible.
Luria y découvre une autre technique d’écrire qui est basée sur le facteur moteur, indemne chez le patient.
Il fallait juste que le patient fasse appel au savoir-faire automatique.
Ainsi écrit-il : « Un beau jour, au cours d’une séance du travail, le professeur s’approche subitement de moi et, très simplement, comme toujours avec ses patients, il s’adresse à moi et me demande d’écrire quelque chose, non plus lettre après lettre, mais sans quitter de la main le crayon ni la feuille.
Après m’être fait redire deux fois la demande, j’ai répété plusieurs fois le mot « sang » et finalement, j’ai pris le crayon pour l’écrire rapidement.
Je ne savais même pas ce que j’avais écrit, étant donné que j’étais incapable de me relire »17.
Après cette découverte, il se lance dans l’écriture immédiate, sans réfléchir.
La décision d’écrire son histoire vient aussitôt et se manifeste en tant que solution subjective.
Il écrit et réécrit son histoire pendant vingt-cinq ans, ce qui aboutit à un travail de 3000 pages.
Une fois la phrase écrite, il l’oublie, étant donné qu’il ne peut plus la relire.
Les mots qu’il trouve ne sont pas suffisamment précis, ce qui le pousse à réécrire encore et encore.
Son écriture vise un travail solide sur son histoire.
La lecture de son texte donne l’impression d’être dans une boucle sans fin.
Il revient là d’où il part et ça se répète à l’infini : « je suis toujours dans le cercle maléfique du temps, je ne peux pas briser le cercle, en sortir pour redevenir sain » 18.
Le statut de ses écrits est frappant, une fois que cela est écrit cela disparaît vu l’incapacité du patient de se relire: « J’essaie d’habitude d’avoir recours à l’écriture automatique tout en restant incapable de me relire, de fait je ne comprends même pas mes écrits » 19, dit Zassetski.
Il y a un trait de l’objet lacanien, l’écriture se détache du corps et quelque chose est d’emblée perdu à jamais.
Pour le retrouver il doit recommencer.
Sans ce travail, dit-il, il risque de tomber dans le néant, dans le trou, où il n’y a plus rien.
Par cette répétition à l’infini il se protège contre ce qui n’a pas de nom, il adhère à la chaîne signifiante par le seul moyen qui lui est accessible afin de se protéger du Réel.
Entre les lignes, on s’aperçoit de quelque chose qui ne cesse pas à ne pas s’écrire, à savoir le traumatisme qui fait trou à la fois dans son cerveau et dans le Symbolique.
Avec son travail d’écriture, il fait une tentative de guérison visant non seulement améliorer la mémoire, mais aussi trouver la réponse à ce qui reste hors sens.
Mais dès que, dans son écriture, il s’approche du moment de l’accident, il ressent la douleur dans le Réel.
Le travail de l’écriture lui permet de changer, de modifier sa place vis-à-vis de l’ensemble des signifiants: il n’est plus la victime qui subit passivement les conséquences du traumatisme, il devient celui qui fait face à sa maladie.
D’un traumatisme muet, il fait « SA maladie ».
Son travail d’écriture, peut-il être considéré comme un acte dans l’orientation psychanalytique du terme ?
Il faut noter la relation particulière que Zassetski entretient avec Luria.
C’est sans doute un lien transférentiel très fort.
Zassetski dépose ses écrits dans ce lieu sécurisé.
Il s’adresse à Luria dans ses écrits, il note toutes ses sensations avec la précision d’un scientifique.
D’un côté il espère avoir la réponse et le remède à sa maladie, de l’autre côté il se rend au service de la science pour apporter le savoir.
Georges Bruner, un collègue de Luria, dit : « Je me souviens des séances que j’avais avec Zassetski, de l’amour qu’exprimaient ses yeux quand il parlait du « professeur ». Je me souviens de l’insistance avec laquelle il se battait contre sa maladie en essayant de comprendre ce que ça veut dire « Nicolas a sauvé Vera », « Tom a frappé Michel », et ainsi de suite. Il faisait ça pour lui-même, pour le professeur, pour moi – pour la science. Il voulait que sa vie aie un sens » 20.
Conclusion
Les derniers éléments fournis dans l’observation mettent en évidence la fonction de l’amour dans cette clinique « romantique ».
Le transfert dans l’orientation psychanalytique du terme est pour Lacan de l’amour adressé au savoir.
Luria a su prendre cet élément clef de la clinique d’une psychologie concrète du fait de l’influence freudienne.
Prendre la dimension transférentielle est aussi prendre celle de la supposition dans le savoir, caractéristique du transfert psychanalytique, supposition qui révèle le trou dans le savoir absolu.
Cette supposition d’une influence freudienne permet d’expliquer l’autre versant clinique inauguré par Luria et qui donnera naissance à la neuro-psychanalyse.
Le débat reste ouvert quant à l’influence de la pensée de Marx dans cette invention de la clinique romantique. L’historien de la philosophie François Châtelet insiste dans son ouvrage sur Hegel 21 pour dire que Marx construit un autre mode de rapport au savoir que celui porté par Hegel, ce dernier ayant cru réaliser dans son œuvre le rêve du savoir absolu.
Pour Marx contrairement à Hegel, la dialectique n’est pas une méthode et Marx oriente de façon décisive la pensée philosophique vers le concret en opposition à l’abstraction hégélienne.
Est-ce Marx qui inspire aussi Luria lorsqu’à partir de sa clinique romantique, il appelle de ses vœux une psychologie concrète ?
Il est frappant, en tous les cas, de retrouver ce terme de « psychologie concrète » chez des marxistes en lien avec la psychanalyse tels que Georges Politzer en France ou Lev Vygotsky en Union Soviétique.
Cela nous oriente vers une approche nouvelle et concrète, pour le coup, des connexions entre Marx, la psychanalyse et la psychologie concrète, objet d’un autre travail.
Hervé HUBERT, Maria KARZANOVA
- Le terme utilisé par Luria afin d’intituler le dernier chapitre de son autobiographie scientifique.
- Lacan J., Séminaire 17 “L’envers de la psychanalyse”, 1969 – 1970.
- Lacan J., “La science et la vérité”, Ecrits II, Seuil, 1999.
- Goethe, Faust, ????
- Le texte de l’autobiographie scientifique écrit par Luria qui n’a pas été traduit en français
- Luria, A., « Une prodigieuse mémoire », dans L’homme dont le monde volait en éclats, Editions du Seuil, 1995, p. 198
- Luria, A., « L’homme dont le monde volait en éclats » dans L’homme dont le monde volait en éclats, opus cité, p. 25
- Ibid., p. 60
- Luria, A., « L’homme dont le monde volait en éclats » dans L’homme dont le monde volait en éclats, Editions du Seuil, 1995, p. 90
- Ibid., p. 67
- Ibid., p. 68
- Ibid., p. 116
- Ibid. p. 173
- Ibid. p. 124
- Ibid. p. 177
- Ibid. p. 96
- Ibid., p. 100
- Ibid. p. 190
- Ibid. p. 104
- Le texte de l’autobiographie scientifique écrit par Luria qui n’a pas été traduit en français
- Châtelet F, Hegel, Le Seuil, Paris, 1968, 199 p.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Le cercle de craie caucasien de Brecht
Ana Schvangiradze
mai 2025

Introduction
Écrite en 1944, Le Cercle de craie caucasien est l’une des pièces les plus puissantes de Bertolt Brecht. Inspirée d’un conte chinois ancien, elle transpose l’histoire en Géorgie, à l’aube d’un bouleversement politique. Comme souvent chez Brecht, le théâtre devient un espace de confrontation entre classes sociales, idées et systèmes de justice. Ce qui se joue ici dépasse la simple querelle autour d’un enfant : c’est une remise en question radicale du droit, de la légitimité, du pouvoir et de la tendresse, de la loi et de l’éthique.
Un conte renversé
Au centre de la pièce, Groucha, une jeune servante, sauve un enfant abandonné par sa mère biologique, Natella, gouverneure fuyant la révolution. Groucha élève et protège cet enfant au prix de mille dangers, s’y attachant profondément. Natella, quant à elle, incarne l’avidité matérialiste : dans sa fuite, elle préfère sauver ses biens plutôt que son propre fils. À travers ce personnage, Brecht critique un système où la richesse l’emporte sur la vie humaine, dénonçant ainsi la logique déshumanisante du capitalisme. Lorsque le pouvoir se rétablit, Natella revient réclamer son fils, non par amour, mais pour récupérer l’héritage du gouverneur.
La question posée par le juge Azdak, figure farfelue, subversive, mais d’une intelligence redoutable est simple : à qui appartient l’enfant ? À celle qui l’a mis au monde ou à celle qui l’a élevé avec soin et tendresse ? La réponse, dramatique et pourtant porteuse d’espoir, inverse les logiques du droit bourgeois : c’est Groucha qui est reconnue comme la véritable mère.
Une justice renversée
La scène du « cercle de craie » donne son titre à la pièce et s’inscrit comme une fable dans la fable. Deux femmes se disputent un enfant placé au centre d’un cercle tracé à la craie. Chacune doit tenter de tirer l’enfant vers elle. L’une tire, l’autre lâche. Celle qui renonce est désignée comme la véritable mère.
Mais cette épreuve n’est qu’un prétexte. Brecht ne cherche pas ici à réhabiliter une morale universelle ou une justice transcendante. Au contraire, il montre que la justice véritable ne se mesure ni à la force, ni au droit naturel, mais au soin, à la responsabilité, au choix éthique. L’acte de lâcher l’enfant, pour ne pas le blesser, devient alors un geste politique exemplaire.
Le juge Azdak, figure clownesque et anarchique, rend ce jugement à contre-courant des logiques institutionnelles. Il incarne une justice « par en bas », celle qui défend les pauvres, les opprimés, les invisibles. C’est là l’une des grandes forces de Brecht : démontrer que la légitimité ne repose pas toujours sur la loi, mais parfois contre elle.
Le théâtre de Brecht : un outil critique
Chez Brecht, le théâtre n’est pas un simple divertissement. C’est un espace de réflexion et de transformation. Fidèle à sa méthode du théâtre épique, il refuse l’identification émotionnelle traditionnelle et impose une distance critique, ce qu’il nomme l’effet de distanciation (Verfremdungseffekt). Les spectateurs ne doivent pas s’émouvoir passivement, mais réfléchir activement. Chaque scène invite au doute, à l’analyse et à la remise en question.
Dans Le Cercle de craie caucasien, cette démarche atteint son paroxysme. Le récit-cadre, un conflit entre deux villages autour d’une vallée fertile, interroge la question : à qui doit revenir la terre ? À ceux qui la possèdent, ou à ceux qui la cultivent ? Là encore, Brecht renverse l’ordre établi en donnant la terre à ceux qui en prennent soin. La parabole se répète : priorité à ceux qui protègent, soignent et travaillent plutôt qu’à ceux qui détiennent la propriété. Une pièce toujours actuelle Qu’il s’agisse d’enfants déplacés, de justice sociale, de partage des ressources ou de rapports de pouvoir, Le Cercle de craie caucasien demeure terriblement contemporain. À une époque où le droit est souvent instrumentalisé pour renforcer les dominations, où la propriété prime sur la solidarité, et où les marges restent invisibles aux systèmes judiciaires, Brecht nous invite à penser autrement. Il ne s’agit pas de rejeter la loi, mais de rappeler que toute loi doit être interrogée à l’aune de ses effets concrets : sert-elle les puissants ou protège-t-elle les vulnérables ?
Dans ce monde en mutation, Groucha et Azdak forment un couple improbable, porteur d’une utopie discrète : celle d’une justice humaine, incarnée, ancrée dans le réel, et non imposée d’en haut. Ce n’est pas la morale qui sauve, mais le geste. Ce n’est pas le droit, mais l’éthique. Et c’est là toute la beauté du théâtre de Brecht.
Bibliographie
Aristote. (1990). Poétique (M. Magnien, Trad. et annot.). Paris : LGF.
Brecht, B. (1949). Le Cercle de craie caucasien. Paris : L’Arche Éditeur.
Troper, M. (2018). Juger sans règles. Le jugement de Salomon et le jugement d’Azdak. À propos du
Cercle de Craie Caucasien de Bertolt Brecht. Droit & Littérature, (2), 183–196.
Valentin, J.-M. (2008). Brecht et Aristote – mais quel Aristote ? Études Germaniques, (2), 185-203.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Amours et sociétés, avec Alexandra Kollontaï
Exposé de Luka Mongelli, formation APPS 2024-2025
Étude de L’amour libre, d’Alexandra Kollontai, Préface de Sophie Coeuré, et du texte Place à l’Eros ailé ! (1923)

A. Kollontaï, est issue de l’aristocratie mais d’un milieu atypique : son père est noble, général, ayant des domaines notamment en Ukraine ; sa mère divorce, fait rare à cette l’époque. Sensibilisée à l’émancipation des femmes, elle s’approche de milieux qui luttent pour cette émancipation, et deviendra la première femme ministre de gouvernement soviétique.
Elle se marie, par révolte, à un cousin éloigné ingénieur, Wladimir Kollontaï. Ainsi elle forge son émancipation personnelle, puis divorce, et quitte la Russie, rejoint la lutte contre le tsarisme, pour la révolution des travailleurs.
A l’Université de Zurich en 1898, ouverte aux femmes, et comprenant des professeurs marxistes, elle devient théoricienne du marxisme, travaille avec Clara Zetkin et milite auprès des femmes. Elle rejoint le parti Menchevik, puis en 1915 le parti Bolchevik. Durant un exil, suite à risque d’arrestation, elle donne des conférences en Europe, notamment à l’Université ouvrière de Bologne, où elle rencontre Gorki. Dans ses écrits révolutionnaires, elle dit poursuivre son apprentissage « parmi les masses » et postule que sans égalité entre femmes et hommes il n’y a pas de communisme. Des portraits élogieux mais aussi ironiques sont faits d’elle dans la presse, comme « walkyrie ou vierge rouge », surnom aussi affiché à Louise Michel, ce qui est absurde, alors qu’elle affirme sa sexualité.
Pendant la guerre mondiale, elle choix de défendre la paix et l’internationalisme, qui doit mener a lutte révolutionnaire, et ayant rejoint le parti bolchevik en 1915, toujours en exil elle participe à une tournée de conférence par le parti socialiste des USA.
Elle se rapproche de personnes militantes, Zetkin, Rosa Luxembourg, mais aussi Lénine. En Février 1917, elle rejoint Petrograd pour accueillir Lénine, et devient une figure importante de la révolution bolchevique. Nommée commissaire du peuple, elle entre au gouvernement, première femme ministre, une des premières femmes au monde à accéder à cette fonction
L’idée que les femmes doivent prendre des responsabilités politiques s’avère comme un échec immédiat, elle a voulu faire démocratie participative, mais échoue, les femmes disparaissent des instance dirigeantes, ce que Sophie Coeuré dans la préface décrit comme « symptôme du fait que les femmes disparaissent de la jeune union soviétique ».
Le livre L’amour libre comprend plusieurs nouvelles, récits de femmes qui s’adressent à la narratrice, Kollontaï, présentant des problèmes en lien avec leurs relations romantiques. Comme nous écouterions des personnes que nous accompagnons, nous suivons les récits de ces femmes aux prises avec les injonctions sociales, et les contradictions liées à leurs désirs.
Nous nous pencherons pour cet exposé particulièrement sur les deux premières nouvelles, qui montrent des liens différents entre femmes, et leurs rapports amoureux aux hommes :
Ainsi dans le premier texte, L’amour de trois générations, une femme s’adresse à la narratrice dans une lettre. Elle parle d’un drame qui la touche, et commence par narrer l’histoire de sa mère. S’en suit l’histoire de trois femmes, de mère en fille, portant des questions sur le couple et les relations amoureuses. Une forme d’émancipation différente et la difficulté de comprendre ce qu’il se passe chez la fille, un transfert générationnel peine à se connecter.
Qu’est ce qui fait sens ? Comment raccorder l’histoire de ces trois femmes, interrogeant l’amour, l’attirance, la sexualité, leur rapport aux hommes et le rapport d’amour entre elles ?
La mère, Maria s’occupe de l’éducation populaire, tient une bibliothèque, et est mariée à un officier, puis elle part avec un camarade, qui fait partie de zemtvo : assemblée provinciale représentant les nobles et les notables, supprimée et remplacée par soviets. La fille, Olga, qui écrit la lettre, naît alors que les deux partent en exil, Maria est qualifiée par sa fille de populiste, alors qu’Olga est marxiste, est en couple avec un camarade communiste, plus âgé et vit avec sa mère. Elle ne se marie pas, mais dans le livre le camarade est appelé son mari. Leur activité déclarée comme illégale, ils partent en exil, mais Olga se cache dans une famille bourgeoise, devient préceptrice, et a une aventure avec l’homme de la maison où elle travaille. Lui-même est amoureux de sa femme, qui représente ce qu’on attend de la femme, effacée, et séduisante, fragile, Olga a de grands désaccord avec l’homme, mais une attirance réciproque. Elle aime toujours son « mari » Constantin. Les sentiments des deux sont clairs : envers l’un et l’autre mais aussi envers leurs conjoints respectifs. Si Olga parle à son mari, l’homme, qu’elle appelle seulement « M » ne parle pas a sa femme.
Concernant sa mère, Olga est honnête mais est confrontée à la demande du choix, sa mère pensant qu’il est obligatoire de choisir un seul homme. La question de ce qu’on appellerait aujourd’hui la polyamorie est ainsi abordée, alors qu’Olga ne semble pas perturbée par la question du choix, mais sa demande porte sur la différence de sentiments entre les deux hommes, sachant que M aussi ressent une différence de sentiments pour chacune des deux femmes.
« Une fois de plus j’essayai d’expliquer a ma mère les deux sentiments qui coexistaient en moi un profond attachement une tendresse pour Constantin, un sentiment de communion spirituelle avec lui, et cette vive attirance vers M, pour lequel en tant qu’homme je n’avais ni amour ni respect » explique Olga.
La question du respect est importante et on pourrait penser que si l’attirance existe, il est difficile de concevoir l’amour pour un ennemi de classe, alors qu’on observe l’important désaccord politique entre Olga et M : M n’aime pas les bolcheviks, Olga lui reproche son libéralisme bourgeois. Maria raconte à ce moment son propre drame, quand elle ne comprend pas l’absence de choix d’Olga, qu’elle appelle une lâcheté. Maria prend parti de M, ce qu’Olga voit comme l’union entre populiste et bourgeois, alors qu’elle préférera Constantin, comme « ami » mais aussi camarade. La jalousie survient entre M et Constantin et alors qu’Olga habite avec Constantin, M part, en ennemi.
On notera l’importance de la difficulté rencontrée, en raison des divergences politiques, mais aussi de la dissonance entre cet amour passion ressenti pour M alors qu’Olga s’oppose à lui, les poussées contraires à l’œuvre dans cette attirance vers l’ennemi de classe, jusqu’à la rupture, qui intervient en fait en raison de la jalousie envers Constantin. D’un autre côté, l’amour vers Constantin est d’abord l’amitié et la camaraderie, il n’a pas cette dimension passionnée, mais Olga le choisit.
Dans Place à l’Éros ailé, Kollontaï dit « On ne peut douter que la Russie des soviets est entrée dans une nouvelle phase de guerre civile. Le front révolutionnaire a été déplacé ; il passe maintenant dans la lutte entre deux idéologies, deux civilisations : bourgeoise et prolétarienne. L’incompatibilité de ces deux idéologies apparaît chaque jour plus clairement ; les contradictions entre ces deux civilisations différentes deviennent chaque jour plus aiguës ».
Dans la suite de l’histoire, Olga vit avec sa fille mais aussi un autre homme : André. La fille, Génia, a une aventure avec André. Ils vivent ensemble, et Génia s’occupe d’approvisionner la famille. Olga est jalouse, mais ce qui la choque est surtout le fait que les deux n’ont pas de remord à avoir eu cette liaison. Pour Génia ce n’est pas de l’amour, c’est une attirance, et elle ne voit pas en quoi elle fait souffrir sa mère car elle ne lui prend pas André. Elle déménage mais s’inquiète de ne plus les aider à la maison. Son rôle est comme celui d’une mère. Quand la narratrice lui parle de l’amour, elle dit qu’elle aime le camarade Lénine. Puis qu’elle aime sa mère. Elle a peur de perdre cette relation, cet amour mère fille, c’est cette forme d’amour qui lui semble le plus important.
Cette nouvelle interroge ainsi habilement les différentes formes d’amour et la manière dont elles peuvent être perçues selon le prisme sociétal, tel que le définira aussi Kollontaï dans Place à l’Éros ailé.
Dans la deuxième nouvelle, Sœurs, la femme qui témoigne vivait un amour tranquille avec son mari, puis se retrouve en difficulté après séparation et manque de moyens : elle ne trouve pas de travail car on lui dit que son mari travaille, et qu’il n’y a pas de travail pour tout le monde. Le problème est que son mari sort et boit, puis un jour il revient avec une fille. La femme laisse passer, puis la situation se reproduit. Elle finit par discuter le matin avec la fille et apprend que celle-ci est dans la misère et que son mari profite donc d’une camarade en précarité pour lui acheter son corps. La fille veut partir sans demander l’argent, la femme insiste pour lui donner, et la fille dit qu’elle pourrait lui demander de l’aide plus tard. Elle la raccompagne, puis quittera son mari, mais quand elle veut retrouver la fille pour demander de l’aide celle-ci est a l’hôpital.
Ce texte interroge sur la précarité des femmes, ainsi que sur le fait que le travail est pourvu d’abord au mari, la précarité financière et la prostitution.
On ne connaît pas exactement l’avis de l’autrice sur ce sujet mais dans le livre elle est critiquée comme exploitation, c’est pourtant de cette manière que la fille est indépendante, sans être liée aux ressources d’un mari.
Se pose la question du travail des femmes, dans un cadre différent du couple, ainsi que les liens qui peuvent se nouer entre ces femmes, victimes de la précarité mais aussi du patriarcat, cette sororité qui pousse la narratrice à quitter son mari, partant avec la femme qui est la maîtresse, qu’elle ne perçoit plus comme un danger mais qu’elle reconnaît comme victime.
Ces textes posent différentes questions relatives à l’amour et aux relations dans une société en mouvement, la place des femmes, et la place des relations, la dimension de l’amour comme « facteur social » développé alors par Kollontaï dans Place à l’Éros ailé : « Devant le visage sombre de la grande révoltée — la révolution, le tendre Éros (« dieu de l’amour ») dut disparaître précipitamment. On n’avait ni le temps, ni l’excédent nécessaire de forces psychiques pour s’adonner aux « joies » et aux « tortures » de l’amour. La prostitution disparaissait, il est vrai, mais par contre augmentèrent manifestement les libres relations des sexes sans engagements mutuels et dans lesquelles le moteur principal était l’instinct de la reproduction non enjolivée par les sentiments amoureux. Ce fait effrayait certains ».
Elle dit ensuite que soit le lien matrimonial est renforcé par la camaraderie, soit les personnes se lassent, l’attraction apparaît et disparaît, c’est ce qu’elle appelle l’éros sans ailes. Mais quand il y a accalmie, après la révolution, l’éros ailé revient Il prend ombrage « de l’insolent Éros sans ailes — de l’instinct de la reproduction non enjolivé par les charmes de l’amour. Qu’est-ce donc ? Une réaction ? Le symptôme d’une décadence dans la création révolutionnaire ? Pas du tout. Il est temps de rejeter une fois pour toutes l’hypocrisie de la pensée bourgeoise.
Il est temps de reconnaître ouvertement que l’amour est non seulement un facteur puissant de la nature, non seulement une force biologique, mais aussi un facteur social. L’amour est un sentiment profondément social dans son essence.
A tous les degrés du développement humain, l’amour, sous différents aspects et formes, il est vrai, constituait une partie inséparable et indispensable de la culture intellectuelle d’une société donnée. Même la bourgeoisie qui reconnaissait en paroles que l’amour était une « affaire privée », savait en réalité l’assujettir à ses normes de morale de telle façon qu’il assure ses intérêts de classe.
D’après Kollontai, l’amour est régi par les sociétés, considéré légal ou criminel, selon ce que le lien entre les personnes va amener à la société. C’est pourquoi il est intéressant de voir que les époques forgent des manières de relationner différentes, et qu’il serait faux de voir seulement l’austérité des révolutionnaires, l’idée du mariage à la cause, mais de voir que simplement les relations changent selon les besoins et les contraintes. Dans une société communiste, détachée du patriarcat et du patronat, la question de l’amour éros ailé revient comme un moteur, un lien renforcé par la camaraderie.
Pistes de travail :
Concernant les personnes en recherche sur leurs relations amoureuses/relations de camaraderie/relations militantes, débutant mon activité de thérapeute et œuvrant depuis plusieurs années dans une communauté LGBT, plutôt militante, dont certaines associations anticapitalistes, il m’arriva justement de rencontrer des personnes qui se posent ces questions :
Le soucis des relations avec des « ennemis de classe », comme c’est le cas pour Olga dans la nouvelle, ou de la nécessité de relationner uniquement avec des camarades, partageant les mêmes valeurs de lutte. La problématique d’une attirance et d’un amour qui ne se contrôlent pas, d’autant plus qu’on partage une certaine oppression et une partie des luttes (associations plutôt assimilationniste ou radicales anticapitalistes) mais les personnes de ces deux communautés se rencontrent et les attirances, les liens se créent, puis les conflits surviennent.
La question est aussi posée de repenser les rapports intimes, par d’autres pistes que le couple. Par la polyamorie sous ses différentes formes, et la réflexion autour de l’amour et de l’amitié qui revient souvent dans les échanges.
Kollontaï précise aussi que selon les époques l’amitié est la forme d’amour placée au dessus de tout, par les exemple de la Grèce et Rome antique, de Castor et Pollux (qui sont cependant à replacer dans un contexte patriarcal et de domination masculine). Alors que le capitalisme au contraire va favoriser l’individualisme et considérer l’amitié comme faiblesse, dans l’époque féodale, c’est l’amour courtois, pour la femme d’autrui qui est chanté par les poètes, amour spirituel qui permet les prouesses de chevalerie, mais qui ne doit pas être satisfait dans le sens sexuel. La bourgeoisie au contraire ne veut plus distinguer amour spirituel et charnel, et installe l’idée que l’amour doit exister dans le mariage, mais sert ainsi ses intérêts.
Les textes de Kollontaï interrogent ainsi les possibilités de vivre différentes formes d’amour, libérées des injonctions sociétales, et montrent le lien entre avancées sociales, droits des femmes et émancipations, ce que nous pouvons étendre aujourd’hui à toutes les minorités. Ainsi on peut postuler que c’est par la sortie d’un schéma contrôlant et aliénant que nous pourrons aider les personnes en souffrance relativement à leurs conditions amoureuses et relationnelles.
Aussi L’Amour libre est inspirant pour moi en cela que je me retrouve dans un rôle similaire à celui de l’autrice, près de cent années plus tard, écoutant des personnes engagées dans des luttes émancipatrices, anticapitalistes mais luttant encore dans leurs contradictions lorsqu’il s’agit de trouver un chemin entre injonctions sociales relatives à l’amour et désirs.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Jun WEI – De la souffrance mentale à l’éveil révolutionnaire

Dans Les Théories sur la Plus-value, Marx critique les économistes classiques comme Adam Smith ou Ricardo sur leur conception du profit, de l’intérêt ou de la rente. Pour lui, la plus-value n’est pas un phénomène économique “naturel”, mais le résultat d’une exploitation. C’est un outil théorique qui nous permet de comprendre ce qui se cache derrière la façade prospère du capitalisme.
En réalité, le capitalisme n’est pas un système d’échange juste, mais un système d’exploitation déguisé sous le mot “salaire”.
Alors, comment les prolétaires, à partir de leur expérience de l’exploitation, peuvent-ils prendre conscience, se rassembler, et devenir une force organisée capable de remettre en cause le système ?
- L’éveil intellectuel en Chine et le témoignage de Lu Xun : l’indifférence du peuple chinois comme produit de l’oppression sociale
Après 1895, alors que la Chine devient une société semi coloniale et semi féodale, les intellectuels chinois commencent à réfléchir à cette question et à s’intéresser à la souffrance du peuple. Le plus célèbre écrivain chinois, Lu Xun (鲁迅), a raconté une histoire lorsqu’il étudiait la médecine au Japon. À l’époque, il pensait que la meilleure façon de sauver son pays était de soigner les corps affaiblis des Chinois. Mais un jour, Pendant un cours, son professeur japonais projeta une vidéo documentaire sur la guerre russo-japonaise. Dans ce film, Lu Xun vit une scène : un Chinois, accusé d’espionnage, était décapité par les Japonais, sous les yeux d’autres Chinois — impassibles, silencieux, presque indifférents. Cette expérience a changé les idées de Lu, il a réalisé que la médecine était incapable de transformer la nation ; et la chine a besoin d’une force d’éveil de la conscience collective.
L’indifférence est regardée comme un résultat d’une oppression sociale ; une fois la conscience éveillée, le peuple doit se révolter contre un système rétrograde, une politique extérieure humiliante et une culture traditionnelle dépassée.
Dans la culture traditionnelle chinoise, la société enseigne au peuple : « Le souverain est la norme du ministre, le père est la norme du fils, le mari est la norme de l’épouse1 »(君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲).
En même temps, elle exige que chacun apprenne à endurer, à dissimuler ses pensées et à bien jouer son rôle. Un tel système renforce l’autoritarisme et le cadre hiérarchique, tout en réprimant la liberté individuelle. Il constitue ainsi un mécanisme de contrôle social intériorisé, qui produit une obéissance silencieuse et une forme d’auto répression marquée par l’indifférence.
Après 1919, les étudiants chinois, éveillés à la conscience nationale, ont organisé des manifestations pour dénoncer l’oppression de l’impérialisme et celle exercée par leur propre gouvernement. Il s’agit d’une poussée contraire, le peuple chinois aspirait à une réforme en profondeur et à la liberté d’expression. Dans le contexte chinois, cette poussée contraire s’inscrit dans une logique de privation collective, non seulement matérielle, mais aussi symbolique — il ne peut pas être privé de la reconnaissance, de la parole, et de l’existence. La tension constitue aussi une contradiction structurelle : elle ne se réduit pas à une dissonance individuelle, mais reflète une organisation historique des rapports sociaux, façonnée par le féodalisme, le patriarcat et la domination impérialiste. Ces contradictions, relayées et reproduites à travers le transfert social, « organisent les mouvements de vie » : elles sont à la fois source de souffrance et moteur potentiel de transformation.
Cette contradiction se rejoue dans chaque corps, chaque silence, chaque geste de soumission.
- La vision révolutionnaire de Mao et la rupture avec l’ordre ancien
Le Parti communiste chinois et Mao ont su percevoir avec acuité cette contradiction, et ont remis en question la société de l’époque ainsi que la culture traditionnelle. Inspirés par le communisme, ils ont voulu rompre avec l’ancien ordre et reconfigurer la conscience collective par la voie révolutionnaire.
Comme l’écrit Marx dans la Préface à la Critique de l’économie politique, « Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais, au contraire, leur être social qui détermine leur conscience. » Autrement dit, les idées ne peuvent évoluer durablement sans une transformation des conditions sociales concrètes.
Dans son article La Démocratie Nouvelle (1940), Mao reprend le cœur du raisonnement marxiste : la plus-value provient du travail non payé de la classe laborieuse. Il montre que l’exploitation n’est pas seulement un phénomène économique, mais une forme d’oppression systémique, inscrite dans l’organisation même de la société.
- Les paysans sont comme sujet politique central
Mao a pleinement accepté le principe fondamental de Marx sur la plus-value, à savoir qu’elle provient du travail non rémunéré des ouvriers. Dans La Démocratie nouvelle, il affirme clairement que la classe des propriétaires fonciers et la bourgeoisie accumulent leur richesse en exploitant les paysans et les ouvriers. Cette exploitation n’est pas seulement un processus économique, mais aussi une forme institutionnalisée d’oppression de classe.
Mao ajoute que « là où il y a oppression, il y a résistance », une formule qui exprime précisément l’explosion de la contradiction au niveau de la pratique sociale : une logique d’action par laquelle les individus et les collectifs cherchent à reconquérir leur souveraineté sur leur propre valeur.
Mao et le Parti communiste chinois ont placé le peuple au premier plan, en particulier les paysans, qui constituaient la majorité de la population chinoise.
Ainsi, ils accordent une place centrale aux paysans dans le processus révolutionnaire chinois.
Mao reconnaît dans cette majorité longtemps marginalisée une force motrice capable de transformer radicalement la société. Le peuple paysan devient ainsi non seulement acteur mais aussi sujet politique de son propre destin, dans une logique d’appropriation collective du pouvoir et de recomposition de l’être social.
De plus, dans ce nouveau régime, une alliance durable entre les paysans, les ouvriers, la petite bourgeoisie et la bourgeoisie nationale, dans laquelle chaque classe contribue à la libération collective.
C’est dans ce contexte qu’il élabore la stratégie des bases révolutionnaires rurales, selon Mao, chaque individu dans la révolution est important : tels de petites étincelles, ils peuvent, une fois rassemblés, embraser toute une plaine.
En conclusion, il n’y a pas de “maladie mentale”, la souffrance mentale est bien un effet d’une poussée contraire.
Mao a vu une potentialité révolutionnaire.
Il ne s’agissait pas de soigner des “malades”, mais d’organiser les masses : non pas guérir un symptôme, mais transformer le régime.
Car, comme le montre l’expérience chinoise, il n’y a pas de maladie mentale en dehors de la société qui produit la souffrance mentale, et c’est dans la lutte que le sujet retrouve sa voix, son corps, et sa capacité d’agir.
Jun WEI
avril 2025
1 Cette maxime résume le principe des « Trois liens » (san gang 三纲) dans la pensée confucéenne, codifié notamment dans le Livre des rites (Liji 礼记) et formalisé sous la dynastie Han par Dong Zhongshu (董仲舒).
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Il n’y a pas de maladie mentale
Vers une psychiatrie différente ?
De Liuba, Cécile, Naomie, Perla
Introduction :
En lien avec l’atelier précédent nous nous arrêterons ici sur le contenant maternel
qu’il soit biologique, familial, amical, institutionnel ou encore entrepreneurial.
Ce pour souligner la poussée contraire qui va caractériser cette matrice oscillant du
plus de vie portée par les soins d’attention à l’autre et au moins de vie portée par les
contraintes de la norme jusqu’au performatif.
Dans le premier mouvement, l’élan vital participera à l’élaboration du Mot-Image-Corps intime ou self authentique winnicottien, dans le second cas l’élan mortifère détruira le Mot-Image-Corps authentique en le vidant de sa substance par transferts de valeurs normées pour imposer le Mot-Image-Corps formaté, attendu, prescrit ou faux self winnicottien.
Corps de texte :
Dans son ouvrage intitulé Devenir Anorexique, Muriel Darmon aborde l’histoire de
l’anorexie en mettant en lumière la façon dont la société fabrique et cristallise des
figures corporelles.

• Au Moyen Âge, les “saintes anorexiques” illustrent un rapport mystique au corps, où la privation alimentaire devient une manifestation de pureté et d’élévation spirituelle.
• Au XVIIIe siècle, une tension entre approche médicale et religieuse déplace le statut de l’anorexie vers une pathologisation progressive.
• Au XIXe siècle, l’anorexie est perçue comme un trouble féminin lié aux exigences sociales de distinction.
La maîtrise du corps devient un marqueur de classe, renforçant la normalisation du contrôle alimentaire.
Dans ce contexte, la mère joue un rôle central : garante de la respectabilité bourgeoise, elle incarne les attentes morales et sociales assignées au féminin.
C’est souvent par son intermédiaire que s’exerce la pression sociale sur la jeune fille, qu’il s’agisse de la préparer à un idéal de féminité sacrificielle ou de faire d’elle un symbole de réussite familiale.
L’anorexie peut alors être lue comme une réponse paradoxale, voire une résistance silencieuse, aux injonctions maternelles intériorisées, elles-mêmes façonnées par les normes sociales dominantes.
La modernité perpétue ce processus de réification : l’anorexie n’est plus considérée comme une personne mais comme un “outil” de performance sociale.
L’industrie de la santé et les assurances rationalisent le diagnostic pour le rendre rentable, figeant
l’individu dans une catégorie rigide.
Le DSM cristallise cette approche en réifiant la pathologie dans une grille narrative institutionnelle, où la parole du patient est discréditée.
Muriel Darmon évoque dans son ouvrage les phases caractéristiques du parcours des personnes atteintes d’anorexie, qui illustrent une véritable “carrière anorexique” :
1. L’engagement dans une “prise en main” : la personne initie volontairement un contrôle strict de son alimentation, cherchant à maîtriser un environnement perçu comme oppressant.
Cette première phase correspond à une redéfinition du rapport au corps, qui devient un objet à discipliner.
2. Le maintien de l’engagement : malgré les alertes médicales et la surveillance, l’individu persiste dans cette dynamique, piégé dans un cycle d’insatisfaction perpétuel.
Ici, le corps subit une cristallisation : il est figé dans un statut d’objet à réduire, à maîtriser, jusqu’à la dépossession de soi.
3. La prise en charge par l’institution médicale : lorsque l’état de santé devient critique, l’individu est pris en charge par des structures de soins, qui imposent un retour à la norme alimentaire.
Cependant, cette phase renforce parfois l’illusion d’un contrôle institutionnel, poussant la personne à adapter
son discours pour simuler une amélioration.
L’hospitalisation, selon Darmon, constitue la dernière étape de la carrière anorexique.
À ce stade, le comportement de la patiente est strictement encadré et surveillé. Sa parole est souvent discréditée, et elle perd une grande part de son autonomie.
Il s’agit d’un moment où le contrôle médical s’exerce pleinement sur le corps : les médecins décident de ce que la patiente peut manger, en quelle quantité, et de ce qu’elle a le droit de faire ou non.
Mais au-delà de cette prise en charge physique, l’hospitalisation peut également renforcer la stigmatisation. Être hospitalisée pour anorexie peut devenir une étiquette sociale pesante, une identité assignée que la patiente doit porter.
Muriel Darmon évoque les « couloirs d’anorexiques », en référence à cette forme d’assignation, où les jeunes filles malades sont regroupées, identifiées et surveillées, comme si elles formaient une catégorie à part.
Ces couloirs incarnent le lieu où l’individu est réduit à son trouble, et où la norme sociale s’impose avec encore plus de force.
L’anorexie est ainsi analysée comme un symptôme de contradictions sociales : le besoin d’affirmation de soi et de maîtrise dans un monde exigeant entre en conflit avec un système normatif qui impose des standards inatteignables.
Cette dynamique conduit à la construction d’un faux self, où l’individu adapte son discours et ses
comportements aux exigences sociales et institutionnelles, au point d’en faire un mode d’existence.
Ces différentes phases traduisent un rapport paradoxal au corps : d’un côté, il est un lieu de soumission à des injonctions sociales, de l’autre, il devient un outil d’affirmation d’une maîtrise absolue.
Ce balancement entre “plus de vie” (idéalisation de la perfection et du contrôle) et “moins de vie” (autodestruction et négation du besoin vital) traduit un conflit identitaire profond.
Dans cette dynamique, la société produit un “meurtre social” en vidant l’individu de sa substance propre, en le réduisant à un état de reclus, voire à un corps à soigner et à surveiller.
Le sujet n’est plus acteur de sa propre existence mais devient un objet de prise en charge institutionnelle.
Ainsi, l’anorexie, loin d’être un simple symptôme individuel, est un produit des normes culturelles et institutionnelles qui imposent un contrôle du corps.
Elle incarne un double mouvement : celui d’un désir de vie sublimé par la perfection et celui d’une
destruction progressive sous la pression sociale.
Le corps, dans ce processus, oscille entre une image subie (corps dicté par les injonctions sociétales) et une image agie (tentative de maîtrise absolue).
Ce conflit traduit une souffrance identitaire où la parole du patient est souvent niée, contraignant ce dernier à une adaptation constante pour exister au sein des institutions.
L’anorexie révèle alors un paradoxe fondamental : la société impose la minceur comme norme de distinction tout en pathologisant les corps qui poussent cette logique à l’extrême.
Dans cette contradiction, le corps devient un champ de bataille entre la normalisation et la révolte, entre le faux self et l’espoir d’un véritable soi libéré des contraintes imposées.
Dans cette dynamique, la figure maternelle occupe une place centrale.
Porteuse, parfois malgré elle, des injonctions sociales de réussite, d’excellence et de conformité, elle peut devenir l’intermédiaire par lequel s’exerce une pression normative sur le corps de la fille.
La relation mère-fille se teinte alors d’exigences implicites de perfection, dans lesquelles l’amour et la reconnaissance semblent conditionnés à la maîtrise de soi.
L’anorexie peut ainsi apparaître comme une tentative d’adaptation extrême à cette demande, voire comme une protestation muette contre une aliénation intériorisée.
Cette logique d’injonctions contradictoires, déjà à l’œuvre dans l’anorexie, se retrouve également dans un autre registre : celui des troubles bipolaires, analysés par l’anthropologue Emily Martin dans “Voyage en terres bipolaires“.

À partir d’une enquête ethnographique menée aux États-Unis, Martin explore la manière dont les états maniaques et dépressifs sont intégrés, valorisés ou stigmatisés dans une société néolibérale.
Loin de se limiter à une approche biomédicale, son analyse interroge la façon dont les normes économiques, culturelles et professionnelles façonnent nos représentations du trouble psychique, et comment les individus tentent de s’y adapter ou s’y brisent.
Dans cette perspective, la bipolarité n’est pas simplement un trouble individuel : elle devient un miroir déformant d’une société qui exige toujours plus, et qui rend pathologique toute forme de débordement ou de ralentissement.
Dans son ouvrage, Muriel Darmon montre que la personne souffrant d’anorexie s’inscrit dans une quête d’excellence, une excellence conforme aux normes imposées par la société.
Cette quête ne se limite pas au corps : elle s’étend également à la culture et à la réussite scolaire.
L’individu cherche à se transformer pour correspondre aux attentes sociales, à travers une discipline rigoureuse et un contrôle constant.
Il ou elle « se fait un corps » et « se fait une culture », selon les termes de Darmon, c’est-à-dire qu’il y a une volonté active de se façonner, de se construire selon des critères idéalisés.
Ce processus implique une modification en profondeur des pratiques quotidiennes, ainsi qu’un surinvestissement dans les domaines scolaire et intellectuel.
L’anorexie apparaît comme une réponse extrême à l’exigence de conformité et de performance imposée par notre société.
Ainsi, l’anorexie apparaît comme un processus socialisé, une manière radicale de répondre aux attentes normatives de performance, de contrôle de soi et de réussite.
La souffrance individuelle devient alors le symptôme d’une pression collective, dans une société où l’excellence est érigée en modèle.
Ainsi, dans l’ouvrage d’Emily Martin, tant que la personne est dans une phase maniaque productive, elle est applaudie : rapide, inspirée, efficace. Mais dès que cela ne rapporte plus, la souffrance est rejetée, pathologisée, assignée à une case.
La personne souffrant d’anorexie commence à intérioriser l’étiquette de diagnostic « anorexique ».
Certaines personnes en viennent à considérer cette étiquette comme un trait de personnalité, quelque chose de stable, voire d’immuable, ce qui peut conduire à un refus de changer leurs habitudes.
Selon Muriel Darmon, cette étiquette est parfois perçue comme moins stigmatisante que d’autres diagnostics, comme celui de la boulimie.
Ainsi, l’identification à cette étiquette peut être acceptée par la personne elle-même, même en dehors d’un parcours médical.
Ce processus peut être lu, en termes d’APPS, comme un meurtre social : la personne cesse d’être perçue comme sujet pour devenir un dysfonctionnement à corriger.
Une violence symbolique majeure, qui efface toute la complexité du vécu.
Ce mécanisme d’effacement ne concerne pas seulement les institutions médicales.
Il traverse aussi le monde du travail, où les normes de performance imposent une régulation émotionnelle constante.
Dans ce contexte, l’entreprise peut être pensée comme une figure maternelle : elle offre un cadre, une reconnaissance, une forme de sécurité, comme une mère qui protège.
Mais cette « mère » est également exigeante et normative : elle attend que son enfant soit autonome, performant, sans failles.
Elle veut l’enfant productif mais pas l’enfant souffrant.
Elle exige la maîtrise émotionnelle, la régulation permanente, et sanctionne l’écart, l’excès ou la fragilité.
On pourrait alors parler d’une mère performative : un contenant qui promet protection, à condition de se conformer parfaitement à ses attentes.
Dans cette logique, l’état maniaque devient un modèle implicite de performance : enthousiasme, créativité, énergie constante.
Cette normalisation émotionnelle produit un faux self professionnel : une façade maîtrisée et brillante, derrière laquelle le sujet cache fatigue, instabilité ou détresse.
Martin montre aussi que les états psychiques deviennent des métaphores dans le langage économique : on parle de marchés « maniaques », de « dépressions » financières.
Ce glissement révèle à quel point les troubles de l’humeur sont intégrés à notre manière de penser la société, non plus comme pathologies à soigner, mais comme ressources à exploiter.
Dans certains milieux, on ne cherche plus à soulager la bipolarité : on tente de l’optimiser.
On valorise les phases hautes, on corrige ou masque les phases basses.
La bipolarité devient alors un symptôme social : celui d’un monde qui valorise la folie rentable mais rejette la fragilité humaine.
Ainsi, ce que donne à voir Emily Martin à travers ce récit, c’est que la souffrance psychique ne peut être détachée des logiques sociales qui la traversent.
L’APPS permet d’entendre cette souffrance autrement : non comme une pathologie à éradiquer, mais comme une réponse du sujet à un monde normé qui ne tolère ni l’écart, ni le vacillement.
En rapport à cette intolérance, cette intransigeance, Erving Goffman parlera d’institution totalitaire.
Il évoquera l’analogie de “la mer morte” dans la façon de contraindre la personne, de la briser, pour la dépouiller de son Mot-Image-Corps intime par la perte de tous ses repères jusqu’à son identité civile parfois.
Pour résister à la perte de ce self authentique, la personne développera des stratégies de défense qui seront alors interprétées comme autant de symptômes et surtout autant de discrédits par l’environnement médical comme familial.
La personne sera alors stigmatisée comme non compliante, donc difficile, refusant de se plier au Mot-Image-Corps prescrit.
Cette stigmatisation entraîne parfois un traitement de ”mise au pas” si rude à tenir que la personne n’aura d’autre choix que de s’y plier et d’accepter d’endosser ce faux self, passant ainsi du faux self subi au faux self agi, elle deviendra alors un patient compliant, malléable.
Erving Goffman dans son livre “Asiles”, décrit cette transformation de survie comme “adaptation primaire”.
Nous retrouvons alors Michel Foucault qui rappelait dans “Dits et Écrits” tome 2 de 1977 que”…dès le départ, la psychiatrie a eu pour projet une fonction d’ordre social”…
Cet ordre social prescrit par la norme du moment, va entraîner du tromper/cacher aussi bien du côté des personnes internées que de leur environnement.
C’est ainsi les personnes anorexiques afin d’éviter cette prise en charge forcée, commencent à mettre en place ce que Darmon décrit comme un « travail de discrétion » et de « leurre », c’est-à-dire un ensemble de stratégies visant à dissimuler leur état.
Elles cherchent à cacher les signes visibles de leur trouble afin d’échapper à l’intervention médicale.
Ce comportement rejoint ce que dans l’apps on appelle le « tromper/cacher » : la personne fait d’aller mieux, de se conformer aux attentes, ou au contraire, dissimule certaines pratiques pour éviter d’être exclue ou hospitalisée.
Ce jeu de dissimulation devient un moyen pour elles d’être acceptées tout en conservant leur comportement.
Ce jeu de simulacres et de dupes devient rapport de force pour gagner le bon de sortie.
La personne ayant subi le “couloir de la trahison” goffmanienne déguisant un problème de comportement social singulier, divergent de la norme, en perturbation organique répertoriée dans le DSM, pour en justifier l’hospitalisation, va à son tour tromper et simuler le comportement attendu.
Elle pourra alors sortir et s’orienter vers le plus de vie de son self authentique ou Mot-Image-Corps intime plutôt que de rester enfermée dans un faux self destructeur ou Mot-Image-Corps prescrit.
Conclusion :
C’est dans l’agencement de cette “carrière morale“ ou élaboration du Mot-Image-Corps que nous retrouvons l’une des boussoles de l’APPS, à savoir “qu’un individu seul, ça n’existe pas”. La personne n’existe que dans un rapport où elle est “agent, effet et produit” de ce rapport.
Ainsi écouter la souffrance sociale dans le mental de la personne, émergeant d’un rapport de valeurs différentes entre elle et la “normose” ambiante, plutôt que de faire taire cette souffrance par contrainte ou redressement, serait une ouverture des pratiques psychiatriques actuelles.
Que ce soit dans l’anorexie, la psychiatrie asilaire ou la bipolarité, ce qu’on voit toujours, c’est un sujet qui essaie de survivre dans un monde trop normé.
La souffrance ne vient pas toujours de l’intérieur, elle est souvent provoquée par le rapport au social, par l’injonction du groupe de référence à la conformité, à la rentabilité, à la maîtrise de soi.
Et l’APPS nous aide à entendre cela : au lieu de chercher ce qui ne va pas « dans la personne », on peut enfin regarder ce qui, dans la société, la fait souffrir.
Liuba Churyla
Cécile Tranier
Naomie Ricard
Perla Karam
avril 2025
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Gloria Anzaldúa et la pensée des frontières : Entre hybridité, oppression et réinvention

Introduction
Gloria Anzaldúa (1942-2004) est une écrivaine, poétesse et théoricienne chicana, dont l’œuvre explore les questions de race, de genre, de langue et d’identité culturelle. Née au Texas, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, elle a grandi dans un environnement où s’entrechoquaient les influences anglo-saxonnes et mexicaines, où la langue elle-même devenait un enjeu de domination et de résistance.
Son livre “Borderlands – La Frontera : The New Mestiza” (1987) (trad. en français : Terres Frontalières – La Frontera : La nouvelle mestiza) est une œuvre hybride, mêlant essai et poésie, anglais et espagnol et un peu de Nahuatl, expérience personnelle et réflexion politique. Anzaldúa y développe une pensée de la frontière, non seulement comme un espace géographique, mais comme un lieu de conflit et de transformation identitaire.
Aujourd’hui, je vous propose d’explorer trois aspects clés de cette œuvre : la frontière comme espace d’oppression et de résistance, la langue comme instrument de pouvoir, et la conscience de la mestiza comme nouvelle manière de penser l’identité.
1. La frontière comme espace d’oppression et de résistance
Pour Gloria Anzaldúa, la frontière entre le Mexique et les États-Unis n’est pas une simple ligne sur une carte. C’est une « herida abierta » selon son propre terme, c’est-à-dire une blessure ouverte où se confrontent le Premier et le Tiers-Monde.
Historiquement, cette frontière n’existait pas. Avant 1848, le Sud-Ouest des États-Unis appartenait au Mexique. Puis, avec le Traité de Guadalupe Hidalgo, ces terres ont été annexées, et ceux qui y vivaient sont devenus des étrangers sur leur propre territoire.
« Nous ne sommes pas venus aux États-Unis, ce sont les États-Unis qui sont venus à nous », pourraient dire les Chicanos. Pourtant, malgré cette présence historique, ils sont traités comme des citoyens de seconde zone, contraints de justifier en permanence leur place.
Mais ce rejet ne vient pas seulement des Anglo-Américains. Il vient aussi du Mexique lui-même.
Ni totalement Américains, ni totalement Mexicains, les Chicanos vivent dans un entre-deux où ils ne sont pleinement acceptés par aucun des deux mondes. Leur langue, un mélange d’espagnol et d’anglais, est considérée comme « impure » : aux États-Unis, on leur dit de parler anglais ; au Mexique, on leur reproche de parler un espagnol abîmé. Ils ne peuvent jamais être « assez » pour l’un ou pour l’autre.
Mais pour Anzaldúa, cette frontière ne doit pas être uniquement un lieu de souffrance. C’est aussi un espace de lutte et de réinvention. Elle défend l’idée d’une « border culture », une culture hybride née de cette coexistence forcée, un espace où se construit une nouvelle identité, qui refuse de se conformer aux modèles dominants.
Et cette résistance n’est pas seulement culturelle : elle est aussi profondément genrée. Les femmes chicanas sont prises dans une double oppression : elles subissent le racisme de la société anglo-saxonne et le patriarcat de leur propre culture. D’un côté, elles doivent lutter pour exister dans une société qui les relègue au second plan. De l’autre, elles doivent composer avec les injonctions de leur communauté : être une épouse obéissante, une mère dévouée, une figure à l’image de la Virgen de Guadalupe. Mais si elles osent briser ces attentes, elles risquent d’être vues comme une Malinche, une traîtresse.
Face à cela, Anzaldúa ne prône pas la soumission, mais la rebeldía. Refuser d’être invisible, refuser de se taire, refuser de disparaître. Son écriture est une affirmation de soi, une déclaration d’indépendance. Elle nous pousse à voir la frontière non pas comme une ligne qui divise, mais comme un espace où une nouvelle culture peut émerger.
Il n’est pas difficile de constater que la frontière est un symbole de normes qui, lorsqu’elles sont appliquées dans des lieux différents, créent des ségrégations différentes. Et l’auteure s’attarde longuement sur la norme de la langue.
2. La langue comme instrument de pouvoir
La langue est au cœur de l’expérience chicana, non seulement comme un outil de communication, mais comme un marqueur identitaire imposé de l’extérieur. Parler une langue, c’est exister ; être privé de sa langue, c’est être effacé.
Dans le chapitre How to Tame a Wild Tongue, Anzaldúa raconte comment, dès l’enfance, on lui interdit de parler espagnol à l’école. Cette interdiction n’est pas seulement une règle scolaire, c’est une violence symbolique : elle vise à imposer une seule langue légitime, celle du pouvoir. Mais la langue chicana est rejetée des deux côtés : trop espagnole pour l’Amérique, trop anglicisée pour le Mexique. Les Chicanos vivent dans une fracture linguistique, condamnés à une parole illégitime.
Anzaldúa refuse ce rejet. Elle revendique le Spanglish, le mélange des langues, non pas comme un compromis, mais comme une langue en soi, un acte de résistance. Écrire en plusieurs langues, refuser la traduction systématique, c’est rompre avec l’idée qu’une identité doit être figée, cloisonnée. Elle détourne la langue imposée pour en faire un espace d’affirmation.
Ce travail sur la langue s’étend aussi à l’écriture. Dans Tlilli, Tlapalli / The Black and Red, elle s’inspire de la tradition pictographique aztèque, où écriture et image sont indissociables. Pour les Mésoaméricains, écrire, ce n’est pas seulement poser des mots, c’est dessiner une mémoire, inscrire une identité dans un langage visuel et symbolique. Cette approche rejoint son projet global : résister, ce n’est pas seulement parler, c’est transformer l’acte même d’écrire.
Ainsi, en brisant les règles de la langue et de l’écriture, Anzaldúa montre que l’identité chicana n’a pas besoin d’être reconnue par les cadres dominants pour exister. C’est dans cet écart, dans cet entre-deux, que naît une conscience nouvelle, un rapport au monde qui refuse les frontières. Mais cette subversion linguistique est-elle suffisante ? Faut-il aller plus loin dans la déconstruction des catégories identitaires ? C’est ce qu’elle explore dans la dernière partie.
3. La conscience de la mestiza – Une identité en transformation
Gloria Anzaldúa clôt son œuvre en introduisant le concept de conscience mestiza : une conscience nouvelle, née du conflit des frontières et du métissage, qui permet d’embrasser la complexité des identités hybrides. Elle ne propose pas seulement une analyse des oppressions vécues par les Chicanos, mais ouvre une voie vers une manière de penser et d’être qui dépasse les catégories rigides imposées par la société.
Dans La conciencia de la mestiza, elle décrit comment la mestiza vit dans un état de tension constant. Elle est confrontée à des contradictions permanentes : entre ses langues, entre ses traditions culturelles, entre les rôles qui lui sont assignés.
La pensée occidentale impose des oppositions binaires – blanc/noir, homme/femme, Américain/Mexicain – mais la mestiza refuse de se conformer à ces schémas. Elle vit dans l’entre-deux et revendique cet entre-deux comme un espace d’expérimentation et de transformation.
Anzaldúa décrit ce processus comme une mutation intérieure :
« La nouvelle mestiza fait face à tout cela en cultivant une tolérance aux contradictions, une tolérance à l’ambiguïté. Elle apprend à être une Indienne dans la culture mexicaine, à être Mexicaine du point de vue anglais. Elle apprend à jongler avec les cultures. Elle a une personnalité multiple, elle agit en mode pluriel… »
Cette conscience mestiza n’est pas statique ; elle est en perpétuelle évolution. Elle nécessite une capacité à naviguer entre différentes perspectives et à réconcilier des identités a priori opposées.
Mais cette prise de conscience ne se limite pas à un processus individuel. Elle implique aussi un changement collectif. Anzaldúa insiste sur le fait que la mestiza ne peut pas seulement exister en tant qu’individu isolé ; elle doit aussi transformer la société dans laquelle elle vit. Elle appelle cela une révolution de la conscience :
- Rejeter les structures binaires : Ne plus penser en termes de dominant/dominé, homme/femme, colonisateur/colonisé, mais en termes de fluidité et d’interconnexion.
- Créer de nouveaux récits : Les Chicanos et autres minorités doivent reprendre le contrôle de leurs propres histoires, en brisant le cadre narratif imposé par la culture dominante.
- Transformer la langue : Comme elle l’a montré tout au long de son œuvre, il ne s’agit pas seulement de revendiquer une langue, mais d’inventer une nouvelle manière de parler et d’écrire, en intégrant plusieurs registres linguistiques et symboliques.
En résumé, la conscience mestiza est donc un dépassement des frontières, une nouvelle épistémologie qui refuse les catégories fixes et les hiérarchies culturelles imposées. Elle est une invitation à penser autrement l’identité, non plus comme une essence stable, mais comme un processus de transformation perpétuel.
Ça nous rappelle la conscience de classe de Lukács. Selon lui, « le prolétariat est la première classe de l’histoire qui pourrait développer une conscience de classe effective et révolutionnaire, là où la bourgeoisie est limitée par une fausse conscience, qui l’empêche de comprendre la totalité de l’histoire. Cette fausse
conscience est celle qui soutient que la période actuelle est universelle, qu’elle durera à tout jamais, là où la conscience de classe prolétarienne, elle, permet d’accéder à la connaissance selon laquelle la situation présente n’est qu’une étape de l’histoire et peut être renversée. »
Donc, sa pensée ne concerne pas seulement les Chicanos : elle propose un modèle applicable à toute personne vivant dans des marges, des tensions, des identités multiples. Elle nous rappelle que les frontières ne sont pas seulement des lignes de séparation, mais aussi des espaces où peuvent naître des mondes nouveaux.
Conclusion
Avec Borderlands / La Frontera, Gloria Anzaldúa propose une nouvelle manière de penser l’identité, la langue et le pouvoir, à partir des marges.
Elle déconstruit les frontières – géographiques, linguistiques ou culturelles – non pas pour les effacer, mais pour en faire des lieux de friction, de résistance et de transformation.
Ce que révèle son œuvre, c’est que la marginalité peut devenir un espace créatif, une source de renouveau. La figure de la mestiza, à l’image du prolétaire chez Lukács, incarne la possibilité d’une conscience nouvelle, forgée dans le conflit, capable de remettre en cause l’ordre dominant et d’en imaginer un autre.
Mais cette proposition, aussi puissante soit-elle, n’est pas exempte de contradictions.
Par exemple, son œuvre, en adoptant une forme délibérément fragmentée et multilingue, produit elle-même un effet de frontière : entre ceux qui peuvent y accéder et ceux qui, comme moi, en sont partiellement exclus. En tant que lecteur, j’ai dû sauter les parties écrites en espagnol, en Nahuatl ou en forme poétique – c’est-à-dire précisément ces segments où l’autrice tente d’échapper aux normes dominantes, des éléments étroitement associés à son vécu. Cette tension soulève une question : comment rendre visible une voix minoritaire sans recréer d’autres formes d’inaccessibilité ? Comment devrions-nous envisager les difficultés de compréhension mutuelle engendrées par la diversité et l’individualisation ?
Une autre contradiction apparaît si l’on tente de faire dialoguer la pensée d’Anzaldúa avec le contexte chinois. À première vue, la Chine semble ne pas avoir de problème de mestiza : il n’y a pas de frontière culturelle visible, pas de conflits identitaires revendiqués, pas d’hybridité manifeste. Pourtant, cette homogénéité apparente cache un autre type de violence — une normopathie, c’est-à-dire une adhésion massive, presque inconsciente, à la norme sociale dominante. Cette illusion de similitude nous fait oublier que chaque personne est très différente.
Dans ce contexte, il ne s’agit pas d’une exclusion explicite des minorités, mais plutôt d’un effacement systématique de toute possibilité d’écart. On n’a pas le droit de sortir de la norme — mais pire encore, sous l’effet du transfert social et du transfert du valeur, beaucoup de gens en viennent à se contenter d’y appartenir.
On se sent du bon côté de l’ordre établi, on croit faire partie de la majorité, alors même que chacun, d’une certaine manière, en souffre. C’est une oppression sans conscience d’oppression — car tout le monde est du « côté des normaux ».
Cela explique peut-être la violence des réactions envers les personnes LGBT+ en Chine : ce qui sort de la norme est perçu non seulement comme illégitime, mais comme une menace existentielle pour l’ensemble du système.
Ainsi, nous sommes également confrontés à la question de savoir comment encourager le pluralisme dans une société qui exclut l’individualité.
Tianhang TAN
avril 2025
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
L’enjeu des Dames dans le jeu des drames humains
Introduction :
Quand on rit de votre faiblesse, que vous faut-il pour que tout cesse ? il faut que vous n’ayez de cesse que tous les faibles soient une armée en marche. Et vous voici une grande force dont plus personne ne rit. (“La mère” du théâtre complet n°3 Page 37) de Bertolt Brecht dont je vais parler avec son autre pièce de théâtre “Mère courage et ses enfants“.

Ces deux titres choisis par l’auteur éveillaient ma curiosité, car le mot mère fait référence indubitablement à quelque chose d’universel, d’accompli, de commun, connu de tous puisque c’est là d’où l’on vient jusqu’à preuve du contraire.
Quant au courage d’une mère, je me suis interrogée sur ce terme courage attribué plutôt aux hommes et rarement aux femmes. Et si elles viennent à en avoir, cela se remarque dans leur audace – elles osent et peuvent faire autant, ou mieux que l’homme.
Bertolt Brecht à l’évidence aimait les femmes comme on a pu le lire, il était curieux d’elles et de leur état maternel.
Mais il y a peut-être, aussi une résonnance avec sa mère Wilhelmine car bien qu’il l’évoque très rarement dans ses écrits, certains critiques pensent que certaines figures féminines, fortes, protectrices et spirituelles font écho indirectement à son image maternelle, celle qui lui a donné la vie le 10 février 1898 à Berlin, une mère protestante décrite comme douce et affectueuse alors que son père Berthold Friedrich catholique, d’une autorité conservatrice était plus distant.
I – Un auteur et 2 mères.
Issu de cette famille d’origine sociale bourgeoise, avec un père directeur de fabrique de papier, ce qui facilite la vie et favorise la bonne éducation. Pourquoi choisir de dire la révolution, le marxisme, de faire la critique du capitalisme et de la guerre, de surcroit par un prisme féminin ?
Bertolt Brecht était un homme de caractère.
Il était dit d’une personnalité complexe et contradictoire, avec un esprit rebelle à la fois provocateur, charismatique qui rejette les valeurs bourgeoises. Les conventions de la bourgeoisie pour lui seraient un obstacle au progrès social. Ce qu’il dénonce dans le récit de La Mère pendant la 1ere révolution russe de 1905.
a) Histoire de La Mère :
L’histoire de la pièce se déroule à Tver en Russie. Et suit Pélagie Vlassova, une femme paysanne russe analphabète. Elle est veuve d’ouvrier et mère d’ouvrier. Elle vit dans la misère et dépend du salaire de son fils Pavel, un militant communiste, qui travaille à l’usine.
Le jour où elle comprend que son fils lit des livres en cachette, elle s’en inquiète et davantage quand il refuse de manger la soupe dégraissée qu’elle a préparé, dégraissé car le kopeck, manque au foyer, elle vit la difficulté de donner à son enfant les 1ers besoins primaires comme boire et manger quand on n’a pas d’argent.
Un matin très tôt, Pélagie voit 4 ouvriers venus chez elle à l’invitation de son fils Pavel. Elle les entend discuter tout bas et se demande ce qu’ils manigancent. Elle entend parler de tracts, elle n’apprécie pas leur présence. Malgré son opposition aux idées de son fils et de ses camarades elle va leur proposer de distribuer ces tracts à l’usine à la place de son fils pour lui éviter les ennuis et le protéger du danger des arrestations des grévistes. Ensuite, elle participera, malgré elle, à une première réunion du projet de mouvement que son fils décide d’organiser encore dans leur maison, car l’endroit est plus sûr pour leur plan de lutte sociale. Puis, sans en être vraiment consciente elle commencera à œuvrer pour la cause ouvrière par le biais de son statut de mère en s’opposant elle aussi à la domination de l’état, aux capitalistes par le biais de Mr Souchlinov, propriétaire de l’usine de son fils devant laquelle elle distribuera les 1ers tracts cachés sous forme d’emballage de sandwichs vendus aux ouvriers. Dans un autre tableau. Alors que son fils est en exil, pour ne pas dire en prison, en Sibérie. Elle va être soutenu par les militants camarades de son fils et un instituteur qui va l’héberger puisqu’elle a perdu son logement à cause de l’activisme de son fils et va lui enseigner la lecture, à sa demande. D’ailleurs elle dira au moment de son apprentissage : « Lire c’est la lutte des classes ».
Après la mort de son fils, arrêté et fusillé alors qu’il franchissait une frontière finlandaise, Pélagie décide de poursuivre son combat pour la cause prolétarienne et devient en quelque sorte la mère de tous.
On remarque à travers le portrait de Pélagie Vlassova que c’est sa nature de mère qui la rallie petit à petit au militantisme de son fils et de ses camarades.
On peut dire là que l’on est dans un transfert de valeurs pour faire le lien avec l’APPS car ici on pourrait croire que c’est le maternalisme qui transmet les valeurs de vie, de l’apprentissage, des idées, alors que c’est le fils et ses camarades qui transfèrent à la mère la motivation d’une révolte sociale, la valeur des mots, pour gagner le droit de vivre dignement.
La transformation de Pélagie s’accompagne, d’une souffrance dans son mental, d’une lutte intérieure entre son instinct de mère protectrice et son engagement politique ; Sa motivation, c’est son enfant, Pavel.
Pour autant, Pélagie sera au début dans des oscillations, dans des poussées contraires.
–ne pas militer (elle dira : « une grève est une mauvaise affaire » ou quand qu’elle explique aux ouvriers, copains de son fils que l’usine appartient à Monsieur Souchlinov autant que sa table à elle lui appartient et que l’on ne peut pas l’empêcher de faire ce qu’il veut avec.
–ou militer par affection pour son enfant.
b) Les aspects psychologiques :
Culpabilité responsabilité, peur, soumission, dilemme. Les aspects psychologiques dans « La Mère » jouent un rôle central dans la transformation du personnage principal, Pélagie Vlassova, – c’est d’abord parce qu’elle est mère qu’elle s’engage au départ à son insu, par instinct ou mécanisme de protection. Puis au fur et à mesure elle prend conscience du contexte social et politique oppressif dans lequel ils vivent et devient une mère militante. Ce changement suit plusieurs étapes psychologiques Pélagie est une mère préoccupée avant tout par la survie de son fils, elle se sent responsable en tant que parent, et coupable de ne pas pouvoir nourrir correctement son fils mais reste méfiante envers toute activité révolutionnaire. Elle accepte son sort comme inévitable et préfère rester en retrait. Dans son cheminement au début : la peur et la soumission face au système social et à l’autorité (patrons, police, système.
La peur est son 1er obstacle. Ce qui reflète la psychologie des opprimés dans des contextes répressifs. Pélagia Vlassova incarne un dilemme psychologique : comment concilier son rôle de mère aimante et protectrice avec un engagement social et politique ?
On a là une dynamique de valeurs. – la valeur maternelle, valeur de justice sociale, valeur du prolétariat, des situations sociales qui viennent la priver de meilleures conditions de vies et contrarient sa valeur de mère à laquelle s’ajoute la valeur de sacrifice. Puisqu’elle sacrifie son logement à la cause. Des valeurs qui ont aussi des poussées contraires. Quand les autres femmes viennent la voir pour pleurer son fils avec elle. Alors qu’elle est en deuil Elle refuse de s’épancher. Sacrifiant ainsi aussi son chagrin de la mort de son fils, pour la cause et par amour pour son fils.
Cela illustre un processus psychologique où l’identité individuelle peut s’effacer au profit d’une identité collective.
Contrairement à Mère courage et ses enfants ou l’identité individuelle/familiale ne veut pas s’effacer au profit du commun. Mais c’est un autre contexte. L’histoire de ce commun se déroule en Pologne durant La guerre de Trente ans, la guerre des religions notamment.
c) Histoire de Mère courage et ses enfants :
Le 1er tableau commence ainsi : Le grand capitaine recrute des troupes pour la campagne de Pologne au printemps 1624 en Dalécarlie et on enlève un fils à Anna FIERLING, l’héroïne de Brecht ; L’histoire suit cette femme surnommée “Mère Courage“, une cantinière qui tente de survivre en suivant les armées durant la guerre de Trente Ans. Elle parcourt le pays, l’Europe dans cette période de 1624 à 1636 avec sa carriole bondée, Accompagnée de ses 3 enfants qu’elle a eu de pères différents dont elle ne se souvient plus très bien d’ailleurs.
Anna vend des marchandises aux soldats, généraux, et au peuple pendant la guerre pour gagner sa vie et faire du profit. Elle traine sa roulotte d’un champ de bataille à un autre, passant des protestants aux catholiques. Elle va là où son commerce peut être rentable, prête à tout sacrifier pour quelques sous afin de nourrir ses enfants.
d) Les aspects psychologiques : Vice et vertu, mensonges, peur, dilemme
Le moteur de Anna est de gagner de l’argent en proposant ses marchandises. L’un des concepts de Marx LA MARCHANDISE : « un objet extérieur, une chose qui par ses qualités, satisfait les besoins humains de quelque nature qu’ils soient » (Marx le Capital )
Tout au long des tableaux Brecht décrit une femme qui est structurée entre vice et vertus (vendre à tout prix, mentir).
On peut dire que mentir est une action mentale, un usage de l’esprit… au service d’une manipulation de la réalité. C’est l’art de faire d’Anna Fierling.
– Avec ce personnage on peut remarquer l’outil de l’APPS le Tromper/cacher. Ses comportements et ses actions sont issus de l’intelligence de la ruse
– La métis des Grecs
– Une intelligence qui s’exerce à des fins pratiques et qui engage une série d’attitudes mentales combinant le flair et la débrouillardise…
Mère courage a peur de perdre ses enfants et agit en roublarde, tout au long de la pièce pour gagner de l’argent certes mais aussi pour les préserver mais cette quête de profit se retourne contre elle, car elle perd successivement ses trois enfants à cause de la guerre qu’elle soutenait indirectement.
Pour faire le lien avec l’APPS et Marx, Anna Fierling est agent effet et produit : Elle fait, cela a des répercussions, des conséquences, elle est donc le résultat de ce qu’elle a fait. Tu as, tu dis, tu es.
Par ailleurs, un autre lien que j’oserais faire avec un des outils de l’APPS le MIC. Ses enfants à eux trois, forment les anneaux transférentiels de l’APPS le MIC (3 valeurs de mot, image, corps)
Dans les descriptions des personnages on peut voir que son ainé Eilif est considéré intelligent, elle dit de lui “audacieux et malin comme son père“
– Eilif serait le Mot
– Pour son cadet Schweizerkas elle le dit- bête mais honnête : il serait image
– Quant à sa fille Catherine, muette, elle l’a fait exister par les gestes et fait parler son corps : elle serait donc le C de MIC, la valeur Corps.
II- L’ENJEU DES DAMES DANS LE JEU DES DRAMES HUMAINS
Brecht avait une prédilection pour les personnages de mères qui, douloureuses, écartelées, dans des dilemmes, sont des figures éminemment populaires.
“De la mère” Roman de l’écrivain russe Maxime Gorki de 1917 qu’il va adapter en 1931 et de la pièce “Mère courage et ses enfants” écrite 8 ans plus tard en 1939 est contextualisée dans la guerre de 30 ans en 1624 alors que Brecht est en exil à cause de la guerre 39/45?
Théoricien de l’art, il veut impacter le public. Quels messages directs et indirects veut-il faire dire à ses 2 héroïnes au public dans son “théâtre qui pique”.
L’auteur utilise la maternité comme moteur initial dans l’implication sociale de Pélagie. On a là un transfert à l’horizontal -de l’individu à la masse pour l’égalité pour la vie en commun. Avec une inversion du transfert traditionnel c’est le fils qui transmet ses valeurs à la mère et non l’inverser. L’auteur dépeint une maternité qui se dépasse, allant au-delà d’elle-même. L’essentiel de l’œuvre réside dans l’évolution de Pélagie.
Pour Mère Courage et ses enfants
Peut-être est-ce les origines des croyances religieuses (père catholique et mère protestante) de ses parents qui lui ont inspiré le contexte de la guerre de 30 ans. L’auteur va dessiner une femme qui socialement, est aussi une femme du peuple. Elle exerce sur ses enfants un maternalisme presque absolu, une possessivité exagérée. Elle ne tient aucune position claire, n’ayant ni ennemis ni alliés, seulement des clients.
Ses rapports avec la guerre : Chez Mère Courage il y a une contradiction fondamentale entre sa volonté de profiter au maximum de la guerre de n’avoir rien à faire avec elle (sauf des affaires) et son désir d’être épargnée par elle ; Anna Fierling peut avoir conscience de cette contradiction fondamentale : à plusieurs reprises elle est sur le point de renoncer à son commerce, de se révolter. Mais elle ne le fait pas, et s’entreprend au contraire de faire preuve de plus d’habileté.
Comme l’a écrit Brecht : « Elle ne s’instruit pas plus que le cobaye n’apprend la biologie dans le laboratoire…
Je n’ai pas voulu l’amener à la compréhension. Ce qui m’importe, c’est que le spectateur, lui, comprenne ». et dans un style de théâtre épique ; caractérisé par un recul prononcé du spectateur sur l’action ce procédé qu’il théorise sous le nom de distanciation est indissociable de l’œuvre dramaturgique de Bertolt Brecht.
“Mère Courage et ses enfants” est donc une œuvre qui questionne le rapport entre l’individu, l’économie et les conflits.
III- LE JEU SOCIAL FEMININ/MATERNEL de Brecht
Dans le contexte de Mère Courage et ses enfants en 1600, Brecht décrit la classe sociale d’Anna Fierling comme une classe intermédiaire (ni patron, ni ouvrier) celle des artisans qui sont leur propre patron. Plutôt individualiste dont les dilemmes sont entre profits personnels et valeurs morales. Brecht dira d’elle : « La guerre n’est pas un désordre qui fondrait sur elle et auquel elle n’aurait pas de part : elle est responsable de sa propre fatalité. Elle opte pour la guerre et son profit. Elle sait pourquoi elle le fait. Elle vit de la guerre ; elle s’acharne à poursuivre sa route malgré les défaites, malgré la mort de ses enfants. »
Comme le dit le docteur Hubert toute mort est un meurtre social dans le rapport aux autres. Il y a le meurtre dans la survie, il y a le meurtre pour vivre.
Pour Pélagie Vlassova Brecht portraitise une femme sans histoires, qui se contente au début du récit de ce qu’elle a, comme d’une fatalité. L’auteur la rallie à la cause ouvrière, prolétaire, par son statut de mère qui va lui permettre d’accéder à la culture par le biais de la lecture et qui la politise finalement. Pélagie devient un exemple de l’idée marxiste selon laquelle les conditions matérielles façonnent la conscience, mais la conscience peut également transformer les conditions.
La pièce fut créée pendant une période où Brecht était très engagé politiquement et cherchait à soutenir le mouvement ouvrier en racontant des classes sociales en confrontation.
L’auteur souligne 2 parcours maternels différents : celui de Anna qui a l’issue du récit a perdu et stagne en ne se remettant pas en cause et qui se maintiendra dans son statut de victime de la société. Et celui de Pélagie, une femme discrète, soumise, au foyer, un rôle dans la normalité de l’époque, qui s’immisce au fur et à mesure dans les mouvements sociaux. Un parcours émancipateur opposé à celui de Mère Courage.
Brecht était un visionnaire, et un précurseur. En ce sens que ses personnages principaux sont des femmes, indépendantes, toutefois il reste un auteur de son temps puisqu’il les cantonne à leur rôle de mère. Parce que l’évolution et la non évolution des 2 personnages passent par le prisme maternel. Il est question de maternité avant la féminité.
Brecht a conçu les personnages comme le résultat d’un contexte et non comme des êtres figés, cela résonne avec cette journée de l’APPS “Il n’y a pas de maladie mentale“, c’est une problématique sociale qui fait souffrance dans le mental, on remarquerait donc plutôt une construction sociale de ces 2 personnalités.
IV- Conclusion
Brecht a écrit 2 pièces morales. Avec des enjeux qui désignent ce que l’on peut gagner ou perdre dans une action et pour sa mise en scène de jeux de rôles des masses et des individus dans les révolutions. On pourrait utiliser sa propre citation : “Celui qui combat peut perdre mais celui qui ne combat pas a déjà perdu.” Brecht utilise la vérité d’une société en difficulté ou en guerre fictionnée dans un style de théâtre épique -porteur de messages à caractère social, une sorte de thérapie par le théâtre incitant le public à la réflexion, donc à prendre part active, en le concernant, par un prisme inattendu, celui du féminin. Pour l’époque c’est très audacieux.
Enfin ces pièces invitent à se poser la question : “Est ce que le chaos de nos sociétés d’aujourd’hui pourrait être rendu au théâtre librement ?“
Geneviève Adt
Avril 2025
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Francis Combes – La poésie ou la folie apprivoisée

Préambule
En préambule je précise que parlant ici de poésie, je n’entends m’intéresser qu’à une de ses dimensions : l’imagination poétique. Son imagerie, en quelque sorte, qui peut parfois être une « imagerie à résonance magnétique ».
(La poésie ne se résume bien sûr pas à cela. Il faudrait pouvoir parler de sa dimension musicale ou sonore. Mais elle a moins à voir avec le sujet. Encore que le rythme et l’aspect lancinant de certains vers, par exemple certaines anaphores, pourraient être considérés comme des survivances d’anciennes pratiques incantatoires, voire de transe… ce qui nous ramènerait à notre sujet).
Ma deuxième remarque préliminaire est plus qu’une précaution oratoire. Je tiens à préciser que je n’ai aucune compétence dans le domaine dit des maladies mentales (ni même plus généralement de la psychologie). Même si, malheureusement, une expérience récente, dans mon environnement le plus proche, me fait découvrir ce qu’elles peuvent entraîner de souffrance.
Poésie et folie, une histoire ancienne
On peut dire de la poésie qu’elle entretient depuis toujours un rapport intime avec la folie.
Dans l’Antiquité, les propos proprement sibyllins de la Pythie de Delphes, que devaient interpréter les prêtres d’Apollon, en est l’exemple emblématique. Certains chercheurs affirment aujourd’hui qu’elle parlait sous l’emprise de gaz neuro-toxiques, notamment l’éthylène qui s’échappait paraît-il de failles dans le sol sous le temple. Quoiqu’il en soit les phrases mystérieuses et incohérentes des Pythies
(car elles étaient plusieurs à accomplir cet office une fois par an) frappaient les imaginations.
Au-delà de cet exemple extrême, pour les anciens Grecs, étaient vraiment poètes non seulement ceux qui possédaient l’art du vers, mais ceux qui faisaient montre d’inspiration, d’enthousiasme disaient-ils. Etymologiquement le mot vient d’« en theos ». Qui porte en lui un dieu.
Le poète est un inspiré, possédé par la parole des dieux. Il ne s’appartient pas totalement.
De même, les Latins distinguaient le Poeta du Vates, le poète-mage. Cette idée de la poésie a été réactivée par le Romantisme.
Avec Hugo, le poète est à la fois « poeta », chanteur, tribun et mage, « vates ».
Les Contemplations sont les « mémoires d’une âme », comme il l’écrit, mais se veulent aussi le livre de tous. Il parle au nom de Dieu, du Progrès et du futur de l’Humanité
On peut considérer qu’il subsiste quelque chose de cette idée du poète-mage dans les conceptions des Surréalistes qui, aux dieux et aux Muses, ont substitué l’Inconscient.
L’approche est rationnelle, voire matérialiste, mais demeure cette idée que la poésie, en son essence, est une parole inconsciente, involontaire, qui échappe à la raison et la déborde.
Après l’inconscient, on est passé au Langage. Pour certains, le poète est parlé plus qu’il ne parle. C’est la langue qui parle à travers lui.
Je crois pouvoir affirmer que cette idée est toujours dominante, aujourd’hui en France. La poésie, ce serait les mots en liberté…
Comme si l’inconscient était le territoire de la liberté.
D’où une certaine défaveur qui persiste envers les époques (et pas seulement le XVIIIe siècle) et les auteurs qui ont mis la raison au premier plan, cherchant à écrire une poésie intelligible et communicable.
Poésie et déraison
En vérité, cette idée n’est pas propre à la poésie européenne, et occidentale.
Ainsi, chez les poètes d’Orient, existe aussi l’idée que la poésie a à voir avec cet état a-normal (au sens de contraire à la vie ordinaire) qu’est l’extase. Chez les mystiques, bien sûr, mais aussi dans toute la tradition bachique des poètes chantant le vin et l’ivresse qui fait dérailler la raison.
C’est vrai par exemple du Chinois Li Bai, de la dynastie T’ang, inspiré par le taoïsme, pour qui le monde est un songe, et qui aimait à boire dans sa barque au clair de lune.
C’est aussi vrai d’Omar Khayyam, le Persan du 11ème siècle, grand mathématicien, philosophe, savant et penseur hétérodoxe. Il chante dans ses quatrains les « filles de la vigne » qu’il préfère aux houris du paradis.
Et lui qui était un scientifique et un esprit rationaliste, écrivait : « Dis aux sages, que pour les amoureux, l’extase est le guide, et que ce n’est pas la pensée qui montre le chemin ».
On a un peu vite fait d’en faire un mystique soufi, ce qu’il n’était apparemment pas. Il chante en fait le caractère éphémère de l’existence, une forme de sagesse épicurienne qui invite à vider la coupe de la vie avant de se retrouver poussière. Cette même poussière dont on pourra faire plus tard des cruches.

Au XIXe siècle, Baudelaire écrira, dans ses Petits poèmes en prose : « Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez vous. »
La liste serait longue à citer de ceux qui ont suivi ce précepte, pas toujours sagement.
De Verlaine, grand amateur d’absinthe, aux poètes américains de la Beat Génération, qui, préféraient les drogues et la méditation bouddhiste. Comme Allen Ginsberg, Jack Kerouac ou Gregory Corso dont les poèmes énigmatiques et forts semblent manifester un état proche de ce qu’on appelle la folie.
Plus généralement, et de façon nettement atténuée, même chez les poètes les plus raisonnables, la poésie est ce qui, tout en étant mêlé au réel, rompt le cycle répétitif du quotidien, introduit de la surprise, de l’émerveillement, de l’inouï dans la vie de tous les jours. Elle est ainsi perçue comme une sorte d’épiphanie, de miracle, pour utiliser un vocabulaire peu matérialiste.
Quelle qu’en soit la forme, on peut dire que la poésie procède d’un usage inhabituel du langage. Qui se distingue du langage commun. A travers le langage, chaque poète est censé manifester un imaginaire singulier, qui peut surprendre le commun des mortels.
Cette dimension de la surprise est particulièrement importante dans la poésie moderne, celle qui s’affirme au XXe siècle.
Ainsi la poésie a-t-elle pu être perçue comme une parole déviante, un écart plus ou moins délibéré à la norme, norme du langage, de la sensibilité voire du comportement social.
Plus encore, tout poète, dans l’expérience de l’écriture, fait l’expérience d’une forme de dépossession de soi, par laquelle il sort de lui-même pour créer un objet qui lui devient étranger, et qui, paradoxalement lui permet de s’affirmer vraiment lui-même.
La poésie serait ainsi une manière d’aliénation positive.
Le cas Rimbaud
Sur les voies qui éclairent le lien intime que la poésie peut entretenir avec la folie, nous rencontrons évidemment Arthur Rimbaud.
Contemporain du Parnasse, tout jeune, il aurait aimé être publié par eux. Mais ils l’ont tenu à l’écart. Et il n’a pas tardé à développer une idée de la poésie en rupture avec leur conception, celle de l’art pour l’art. Conception essentiellement esthétique, qui fut celle de ces poètes post-romantiques, comme Théophile Gautier, et qu’a partagée Baudelaire pour qui le but de l’art est l’art.
Pour Rimbaud, la poésie est bien plus que ça. Elle est une aventure vitale, une expérience existentielle.
La lettre dite du Voyant, à Paul Demeny, éclaire son idée :
« Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant. Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d’amour, de souffrances, de folie ; il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n’en garder que les quintessences. »
J’attire votre attention sur l’adjectif utilisé par Rimbaud, le dérèglement raisonné de tous les sens… Le dérèglement de tous les sens est une action délibérée et qui relève de l’auto-analyse psychologique dans laquelle le poète devient son propre cobaye.
Cela nous indique déjà une différence majeure avec la folie ordinaire. Là, nous sommes en présence d’une folie volontairement provoquée et dans une certaine mesure controlée.
Par cette aventure poétique et humaine qui va jusqu’à côtoyer la folie, Rimbaud anticipe ce qu’allait être le surréalisme au début du siècle suivant.
Ce qui distingue Rimbaud et qui a autorisé à parler à son propos de génie, c’est la rapidité de son parcours, la fulgurance de son intelligence poétique. En très peu de temps, quelques années, il fait le tour de la poésie de son temps et d’une certaine manière, du temps qui suivra. Puis il en reviendra… Quand à son retour du Harrar, hospitalisé à Marseille, on l’interroge sur ses poèmes il réplique que cela ne l’intéresse plus.
Mais il le dit déjà dans certains textes majeurs qu’il nous a laissés.
Ainsi, dans La Saison en enfer, publié à compte d’auteur grâce à l’aide de sa mère, il écrit :
« La vieillerie poétique avait une bonne part dans mon alchimie du verbe ;
Je m’habituai à l’hallucination simple : je voyais très franchement une mosquée à la place d’une usine, une école de tambours faite par des anges, des calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d’un lac; les monstres, les mystères, un titre de vaudeville dressaient des épouvantes devant moi.
Puis j’expliquai mes sophismes magiques avec l’hallucination des mots !
Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit.
(…)
(Pour ma part, je pense qu’il fait directement allusion à l’écriture de certains textes des Illuminations, sans doute antérieurs à La Saison.)
Puis il conclut :
« Cela est passé. Je sais aujourd’hui saluer la beauté. »
Et aussi :
« Esclaves ne maudissons pas la vie. »
Ou encore « Il faut être résolument moderne.
Point de cantiques : tenir le pas gagné. »
Car le Rimbaud, précurseur dans l’exploration de l’inconscient individuel, était aussi un homme de son époque, marqué par l’essor de l’esprit scientifique, par le rêve des colonies, et, contradictoirement, par celui de la révolution. On sait qu’il a pris part à la Commune et qu’il en partageait l’idéal.
Son mot d’ordre « changer la vie », peut ainsi être lu du point de vue individuel comme du point de vue collectif.
Même si Rimbaud brille d’une lumière particulière du fait de sa trajectoire de météore, on pourrait faire la même observation pour d’autres poètes.
Isidore Ducasse dit Lautréamont, a connu une évolution semblable, si on compare les Chants de Maldoror à l’imagination sombre et folle et Les Poésies, très rationnelles où il affirme que la poésie doit être faite par tous et doit avoir pour but la vérité pratique, formules que reprendra plus tard à son compte Paul Eluard.
L’évolution de la plupart des Surréalistes témoigne de la même aventure : l’exploration de la psyché individuelle au risque de perdre le contact, la capacité de communiquer avec les autres, puis, sous l’effet des menaces du fascisme et de la guerre, le retour sur le sol du réel social et collectif. Avec l’engagement dans la Résistance et la lutte pour la paix après guerre.
Tout en gardant en général la marque de ce voyage intérieur.
La poésie comme folie apprivoisée
Ce que nous disent ces aventures poétiques, c’est que la folie fait partie des aptitudes humaines.
L’homo sapiens, comme l’écrit Edgar Morin, est en même temps un homo demens.
(Et de nombreux exemples dans l’actualité sont là pour nous le rappeler).
L’être humain, qui est doué de raison, est aussi doué de déraison. Il possède une faculté, peut-être unique dans le règne animal, de réflexion et d’imagination. Sa pensée, qui naît du contact avec le réel, a la capacité de s’en croire détachée, de s’en évader et même, comme on dit familièrement de « battre la campagne ».
Pour reprendre l’expression heureuse de la romancière et poète canadienne Nancy Huston, l’homme (et la femme) appartiennent à une « espèce fabulatrice ».
L’être humain ne peut pas vivre son séjour sur terre, sans se raconter des histoires, sans s’inventer des mythes, des religions, des idéologies, faites évidemment d’erreurs et d’illusions mais aussi d’espérance.
Cette faculté spécifique à l’espèce humaine peut être (et est souvent) sa malédiction, mais c’est aussi sa chance. C’est en elle que réside sa liberté, sa capacité à se libérer imaginairement et pratiquement de la fatalité.
Cette faculté peut entraîner une vraie souffrance quand elle perd pied avec le réel, mais c’est aussi elle qui rend possibles l’art et la poésie.
Essayant de parler des rapports entre poésie et folie je ne peux évidemment pas écarter les cas de poètes qui ont effectivement souffert de troubles mentaux et se sont trouvés par là placés à la jonction de la poésie et de la folie.
Hölderlin, vivant reclus pendant trente-six ans dans une tour à Tübingen et qui écrit dans cette période de sa vie des poèmes assez étonnants de simplicité voire de platitude ;
Germain Nouveau, le poète amoureux des Valentines, devenu mystique qui s’est laissé mourir de faim dans un pigeonnier de Pourrières,
Gérard Labrunie, dit Nerval… Il souffrait d’obsessions et d’hallucinations pendant lesquelles il avait l’impression que la moindre parole dite en sa présence le visait et recélait un message secret, ésotérique, en rapport avec l’histoire de l’humanité et l’ordre du cosmos. Il est mort, pendu à une grille d’égout rue de la Vieille Lanterne près du Châtelet. Il a été soigné par le docteur Esprit Blanche qui l’encourageait à écrire à des fins cathartiques. Outre ses poèmes parfaits et des nouvelles où le réel et le rêve se mêlent, on lui doit des formules comme « je suis l’autre », écrit au bas d’un portrait de lui, probablement dans un moment de crise.
Ce qui fait bien sûr penser à « Je est un autre », de Rimbaud.

Mais dans un autre moment, car il avait de grands moments de lucidité, en préface à ses poèmes, il écrit « la vie d’un poète est la vie de tous ». Il a aussi inventé le mot « supernaturalisme », qui anticipe le surréalisme.
Il faudrait aussi parler d’Antonin Artaud, bien sûr. Par-delà la valeur proprement poétique de ses textes qui l’apparente au surréalisme, je suis frappé par la précision et la lucidité, avec laquelle il décrit les maux dont il souffre dans ses textes en prose ou ses lettres à Jacques Rivière.
Outre ces cas célèbres pour la poésie française, on pourrait citer d’autres poètes, comme le Russe Vladimir Maïakovski ou le Hongrois Attila Jozsef, qui ont souffert de mélancolie, d’enthousiasme et de dépression, – ont été « cyclothymiques » ou « bipolaires » comme on dit maintenant car il faut toujours mettre des mots sur les maux – et que cette instabilité caractérielle les a poussés au suicide.
On peut quand même observer que sauf rare exception, ce n’est pas dans les périodes de crise que ces poètes ont produit leur œuvre. Mais au contraire, dans leurs moments de grande lucidité.
C’est qu’il y a, à mon sens, trois traits essentiels par lesquels l’imagination poétique se distingue de la folie. Et même s’y oppose.
1 – le premier, c’est l’éveil de la conscience.
En règle général le poète n’est pas le jouet de ses imaginations. Il n’est pas la dupe de ses visions. Il ne confond pas le réel et le rêve. Robert Desnos, prenant ses distances avec l’expérience surréaliste, écrit : « une place pour les rêves, mais les rêves à leur place ».
Même si l’apparition des images poétiques peut-être en grande partie spontanée, involontaire (provoquée par les Muses, l’inconscient ou les automatismes du langage), ils les accueillent et en font un usage « raisonné », comme dirait Rimbaud.
Le poète, en artisan des mots, choisit les images qu’il retient. Celles qui lui paraissent porteuses de sens, de beauté et de force.
2 – le deuxième trait, c’est la vérité de l’image poétique.
Le fait que les poètes ne soient pas dupes de leurs images ne veut pas dire qu’ils n’y croient pas, qu’ils ne croient pas à leur vérité.
Quand Eluard écrit « La Terre est bleue comme une orange », il ajoute immédiatement ce vers : « Jamais une erreur les mots ne mentent pas ».
Il y a une une vérité, une justesse de l’image poétique quand elle s’impose et qu’elle est comme il le disait lui-même « évidente »
D’où l’idée, et parfois la prétention, d’utiliser la poésie comme moyen d’accès à la connaissance. Avec l’apparition, en France notamment, au XXe siècle, de ce qu’Alain Badiou appelle les « poètes-philosophes ».
Le rapport que la poésie entretient avec la connaissance est multiple. On peut relire à ce propos le discours de Saint-John Perse lors de l’attribution du Nobel. Si la poésie peut être source de certaines connaissances, elle se nourrit aussi des connaissances de son temps. Le temps scientifique que nous vivons est à cet égard un immense réservoir à étonnement et à merveilleux.
De mon point de vue, la vérité de l’image, parfois la plus folle, ne relève pas, sauf exception, du fait qu’elle nous apporterait une connaissance plus grande du monde objectif, mais du fait qu’elle formule avec force la vérité d’une expérience subjective. Et elle est par là incontestable.
3 – le troisième trait par lequel l’imaginaire poétique, même le plus fou, se distingue de la folie, c’est qu’il est ordonné par un désir de nature esthétique. Il remet le monde en ordre selon cette loi toujours à réinventer du désir. Même si ce n’est pas son intention délibérée, il produit une forme de beauté, et donc de plaisir et de joie.

Fondamentalement, le délire poétique est heureux. Même quand il conduit à écrire des poèmes tristes. Ceux-ci conservent du bonheur une certaine capacité de consolation.
On pourrait faire le même constat pour d’autres artistes, comme les musiciens. Même dans la composition de symphonies tragiques entre une grande part de jubilation que l’orchestre peut ensuite communiquer à l’auditeur.
Ainsi, pourrait-on dire que la poésie est une forme de folie douce et heureuse. Une façon d’essayer d’apprivoiser notre aptitude intime et collective à la folie.
Elle est donc souhaitable et nécessaire. Je ne sais pas si elle peut sauver le monde, mais elle peut y contribuer ; elle fait ou elle peut faire du bien.
Pour finir, et insister sur l’alliance originale de raison et de déraison dont la poésie est le nom, je voudrais invoquer trois poètes.
Deux étrangers et un Français.
Le grand poète hongrois du XXe siècle, Attila Jozsef, déjà cité, intellectuel marxiste passionné de psychanalyse, introducteur de Reich en Hongrie, lui-même atteint de troubles sérieux et qui a fini par se tuer en se couchant sur des rails.
Il écrit que lorsqu’il se met à sa table pour écrire un poème, il sait qu’il va devoir faire tenir ensemble des éléments contraires de la réalité. Le poème est ainsi défini de façon très dialectique comme « unité des contraires ».
Le poème peut en effet être un lieu où se conjugue et se féconde ce qui est si souvent divisé et opposé dans la vie quotidienne : la logique et le sentiment, le rêve et la réalité, la raison et la déraison.
Ensuite, le chilien Vicente Huidobro, auteur du Manifeste du Créationnisme. Lui, définissait la poésie comme un « délire super-conscient ». Définition que je reprendrais volontiers à mon compte.
Enfin, le poète français Robert Desnos, mort en déportation au camp de Terezin. Il fut l’un des plus doués du groupe surréaliste, capable comme personne d’allier le langage populaire le plus familier et la plus haute imagination poétique.
Dans un bref texte écrit en janvier 1944, à Paris, peu de temps avant son arrestation, il dit :
« La poésie peut être ceci ou cela. Elle ne doit pas forcément être ceci ou cela… sauf délirante et lucide. »
Et cela dit bien sa double nature, contradictoire.
La poésie, comme l’être humain, est par nature sujette à des « poussées contraires » !
Pour moi, la poésie est une forme de conscience sensible. Et je formulerai l’hypothèse que dans le monde passablement fou qui est le nôtre nous avons grand besoin d’une poésie de la lucidité.
Francis Combes
16/04/2025
Mgter. Maria Rosa Pronesti : LA INQUIETUD DE LA FALTA EN SER
Nous sommes heureux de publier ce texte important de Maria Pronesti. qui pratique la psychanalyse en Argentine.
Nous avons à l’APPS abandonné en 2021 toute référence à la psychanalyse en quittant le terme de “psychanalyse sociale” et nous développons depuis l’analyse pratique concrète des transferts de valeur et l’analyse du transfert des contradictions sociales dans le mental.
C’est en référence avec cette analyse des contradictions et sa dialectique pratique que nous publions un texte psychanalytique. Il s’agit en effet de travailler dans les oppositions dialectiques de valeurs qui fondent le travail intersectionnel. Nous le publions car Maria Pronesti travaille la base du social qui nous est commune et c’est à partir du commun qu’il convient d’analyser les différences.
LA EXPERIENCIA Y EL PENSAR

“Cuál es el gran dragón, al que el espíritu”
“no quiere llamar ya señor ni dios?”
“El gran dragón se llama ‘Tú debes’.”
“Pero el espíritu del león dice ‘yo quiero’.”
Nietzsche, “Así habló Zarathoustra”
A partir de una imagen reflexionaré sobre las virtudes del psicoanálisis y su convocatoria del deseo, promotor de un goce vital del sujeto. Pensaré también sobre la eficacia de la didáctica de la filosofía a niños y adolescentes, en lo que significa la experiencia del pensar, en relación al arte y la ciencia.
Con respecto al concepto de experiencia les adelanto que, debido a su complejidad y a su relación con la historia de la filosofía, lo voy a considerar en su devenir, primero como constitutivo del proceso gnoseológico de la “relación sujeto-objeto” del sujeto moderno y sus avatares, siempre ligado a la certeza.
Luego, lo haré enmarcando su incidencia en la subjetividad, con la subversión que Lacan, desde su práctica, teoriza acerca de la lógica del cogito cartesiano. Momento en que, pienso, se produce una crisis del sujeto de la experiencia basado en la certeza.
De Descartes a Kant, hubo una torsión del punto de apoyo del sujeto hacia el objeto. Kant concibe, justamente, como un giro copernicano su aserción de que el sujeto es activo para conocer pues, hasta él, se había sostenido al objeto imprimiéndose en el sujeto. Voy a sintetizar:
A través de la Estética, la Analítica y la Dialéctica Trascendentales Kant despliega, respectivamente, los conceptos de Sensibilidad cuya facultad es percibir (mediante las formas puras o a priori espacio y el tiempo –condiciones de posibilidad de toda experiencia); de Entendimiento cuya facultad es comprender los fenómenos referidos a un concepto (conceptos a posteriori de la experiencia y puros o categorías); de Razón cuya facultad es la de argumentar. Argumentaciones que resultan ilegítimamente correctas cuando se aplican a Dios, la libertad y la inmortalidad (metafísica).
De manera que el filósofo oscila entre un empirismo, cuando afirma que el conocimiento necesita de la experiencia y un racionalismo que sostiene que no todo el conocimiento provendría de la experiencia. Aunque ésta siempre se dirime en oposición y en referencia a la cientificidad del conocimiento ligado a la certeza, en el acto del conocimiento. Desde Descartes, la certeza enmarca al cogito: allí donde pienso, allí yo soy ciertamente.
Pero qué dijeron otros filósofos acerca del pensar?
Hay una aproximación de Heidegger al problema del pensar relacionado a un proceso que él llama “desertización”, a propósito de una crítica a su época, y al espíritu de “progreso”. En “Qué es pensar” (“Was heiBt denken?”) dice: “(L)o que más merece pensarse en nuestro tiempo problemático es el hecho de que no pensamos” .
En la quinta lección afirma: “…el aprender no se puede lograr a fuerza de regaños” “pero a veces hace falta gritar” porque -y cita Nietzsche: …”¡el desierto crece!…” “¡Ay de aquel que guarda desiertos!”. Allí introduce la “desertización” como ”el rápido curso de la expulsión de Mnémosyne…”
Para Heidegger el pensar se presenta en el ser. El pensar es como el árbol florido al que si no avistamos al caminar ante él, estará escabulléndose. El ser como presencia del ente. Estará allí desde siempre; como ob-jectum; pero sustraído a la mirada. Caminar en el bosque hasta llegar al claro, después de saltar el abismo. Una metáfora del método heideggeriano.
Es una crítica al ser de la metafísica presocrática hasta la filosofía medieval en que, desde Sócrates, se lo ha encubierto con el ente. Todo lo que transcurre como pensamiento es una re–presentación, vía imagen, que se hace el hombre de las cosas, no un verdadero pensar.
Como vemos hay un pasaje del registro de lo óntico a lo ontológico. Del ente al ser del pensar. Se de-vela el ser del ente en la casa del Ser. El Dasein, el ser ahí del hombre. Pensar se alcanzaría por un Acto de intuición –fenomenológico existencial, del ser de la ex-sistencia, es decir, pre intelectual, empírico, donde, curiosamente, si conocer no es pensar, desaparece nuestra relación sujeto-objeto.
Heidegger llama desertización a un proceso devastador de raíz. A mi entender, y en cierto sentido, yo rescataría este nihilismo entendido como desierto estéril de toda fertilidad. Es el nihilismo moderno que impulsa a todos al desierto del aparente perfecto conocimiento, pero sin Mnémosyne. Sin la rememoración, el llamado del anhelo que nos piensa.
No es el transcurrir necesario a la creación, como alguna vez lo entendió Nietzsche en su juventud, al mencionar con el significante wildnis una forma positiva del nihilismo del desierto en el que, necesariamente, debiéramos sumergirnos para crear.
Sin embargo, en Nietzsche se encuentra también el significante que negativiza la metáfora del desierto. Es la palabra wüsten, sustantivo del que deriva un adjetivo que alude un desorden, causa de libertinaje. Wüste califica un desierto que solamente deja crecer ciertas plantas cuya fortaleza y resistencia intrínseca les permiten sobrevivir.
Veo aquí una metáfora, exquisitamente siniestra, de la ideología nazi que solo creía en la sobrevivencia de cierta raza como “viable” para la cultura -la raza aria. También, creo yo, inspira a cierto liberalismo o neoliberalismo actual que rescata, en su esencia ideológica, un darwinismo social en el que sólo los más fuertes o resistentes a la incertidumbre o licuación económica, que les corresponde soportar, lograrían triunfar.
Hoy, desde nuestro atalaya histórico podemos testimoniar, que tanto Nietzsche como Heidegger cedieron en su deseo frente al torpor de sus respectivas épocas.
Mientras Nietzsche va apagando su voz y va entregándose a la locura, abandonando su grito en el silencio de su propio desierto -su propio wüsten; el Heidegger de la década del ’30, cae en la trampa cuando cede en su deseo y se aboca, desde el púlpito del saber, a la voluntad de poder, convalidando un desierto devastador.
Opta por cooptar al otro a una ideología hegemónica al apoyar al nazismo naciente de Hitler desde la cátedra, como rector de Friburgo. Es decir, escoge el goce que le da la certeza del poderío nazi, dejando así caer la disposición a la inquietud de pensar.
Pero, por qué el verdadero pensar es inquietante?
EL SILENCIO DE LOS SIGNIFICANTES EN EL MALESTAR DE NUESTRA CULTURA.
Para Heidegger el Otro Pensar es la des-ocultación de una verdad, la Aletheia griega.
Su crítica a lo que es el no pensar coloca a la literatura de su tiempo en el casillero de lo aburrido. Se quiere pensar desde lo abominable de la época y se habla del ocaso de Occidente, dice. Veo aquí una clara alusión a la obra de Albert Camus.
Hay que reconocerle a Heidegger un optimismo tout court en esta persecución del pensar y su epifanía casi diría como destino del hombre por fin esclarecido de lo que se le sustrae. Sin embargo, nuestro presente no le da la razón, en cierto modo.
Camus llamó al siglo XX siglo del terror. El siglo pasado que podríamos decir que no pasa. Un tiempo en el que proliferó en el mundo un silencio “desatinado” y atronador. No es el silencio de los sonidos sino de los significantes, el que tuvo sumida a la humanidad a una violencia, originaria en el hombre y que éste experimenta en el absurdo.
Para Camus, sería necesario reconstruir un goce por afuera del mundo de las cosas, que está repleto de un silencio pleno. “Il faut se revolter”, dice. Hay que sublevarse, indignarse frente a este estado del mundo. Hay que escuchar al otro. Este acto ya es revulsivo. A la cooptación el escritor opone la persuasión, la disposición al diálogo.
Hoy, es preciso ahondar sobre cuál es el sonido furioso del silencio del desierto en el que estamos inmersos, en el malestar actual de nuestra cultura. Es un grito munchiano que tiene como horizonte la certeza de la robótica. Es un silencio rugiente, apestoso, que avala una tecnología que eyecta lo humano como un resto. Sin palabra y sin Simbólico. La mirada es reemplazada por el ojo y la escucha por el oído. La piel por el vidrio del celular. El porvenir es el robot actual y el del siglo que viene. Como verán la peste finalmente ha llegado.
Hay un todo-imaginario deglutido en las redes. Una retórica. Un draconiano “Tú debes”. Habrá que sublevarse, entonces, enseñando filosofía a los niños y a los adolescentes. Devolviéndole al discurso el interrogante socrático que convoca, en el lazo social, la inquietud de la falta de sentido a favor del deseo. Aunque la cicuta esté esperándonos a la vuelta de la esquina.
La peste es la imposición al montaje de ese silencio de significantes en el mundo. El ruido de las bombas, del televisor prendido, del cable en la oreja. Un grupo de adolescentes enfocados en sus celulares al costado de una obra de arte que no es interrogada. El todo-imaginario, la Internet, prevalece.
Imposibilidad de diagramar nuestro mundo para inventarlo una y otra vez. A la manera del diagrama que pinta Bacon en sus telas. Espacios inéditos dentro de espacios convencionales. Nuevas figuras dentro de las figuras para salir de lo figurativo. Significantes que se intercalen en un bien decir para descubrir nuevos. Y así expresar lo inexpresable.

Frente al silencio de los significantes de nuestra época, qué puede hacer el Psicoanálisis?
LA INQUIETUD DE LA FALTA DE SENTIDO
La expresión “Non-sense!” de los ingleses en el lenguaje corriente para invalidar el dicho del otro, se traduce en nuestro “No tiene sentido!” que se usa en el mismo contexto. Destaco que el “Non sense!” no denota precisamente ninguna inquietud relativa a la falta de sentido sino lo contrario. Ubica un goce en la certeza, en la solicitud compulsiva del saber y no de la verdad. Generando un pensar que llamo “de acumulación objetivante”.
El malestar “actual” sigue la misma evolución moderna del lenguaje del discurso corriente: al pasar de un “esto soy” (“ce suis-je”) al “soy yo” (c’est moi”), es decir, “esto es yo”, el sujeto moderno se desentiende de su responsabilidad.
“El yo del hombre moderno ha tomado su forma… (…) …en el callejón sin salida dialéctico del ‘alma bella’ que no reconoce la razón misma de su ser en el desorden que denuncia en el mundo.” Esta mirada de sí, aunque necesaria, es objetivante. Cito: ”es esta enajenación (alienación) más profunda del sujeto de la civilización científica…”.
Un ejemplo: la identificación a los productos lenguajeros psicoanalíticos modernos; el individuo se autocalifica ‘histérico; ‘obsesivo’; ‘fóbico’; ‘drogadicto’; ‘transexual’. Sin embargo, en el mejor de los casos son las posibles posiciones neuróticas –o no, del sujeto transferencial.
¿Por qué el sujeto adviene “histérico” u “obsesivo” sólo en relación transferencial?
EL DESIERTO CRECE Y EL DESAMPARO ES SU MARCA.
Una respuesta es: porque en el desierto al que hemos sido arrojados hay Otro que nos precede. Es el A(otro) del lenguaje. Soy hablado por este Otro del lenguaje, y en tanto es así, este Otro habla en mí y determina mi estructura, cada vez que establezco una relación de demanda de amor, que de esto se trata la relación transferencial, se desenlaza una rememoración de mi relación con el Otro primordial. Encarnado, éste permite que mi necesidad se desdoble en demanda de amor. Se trata de convocar, desde el analista y mediante la impostura de un Sujeto Supuesto Saber, al sujeto del inconsciente (Icc.)
Existe una experiencia nihilista fundacional del ser hablante, que remite al primer llanto de dolor. Es la llamada al Otro, cuya eficacia al responder nominando ese sufrimiento, determinará la dimensión del trauma del desamparo inicial. Si no hay respuesta, la desertización del Otro crece y esta experiencia puede llevar a la muerte biológica. René Spitz lo llamó “hospitalismo”.
Hay otro tipo de ausencia de la cual depende la capacidad de simbolizar de un bebé. Si casi todo en la crianza va bien nace el pensamiento como experiencia estética y el símbolo como modo de referencia al Otro(A), en una operación de hacer de una ausencia una presencia, pero ahora diferente al referente.
Freud nos regala un recuerdo de su nieto jugando al carretel, desenrollándolo a la voz de ¡Fort! ¡Da! ante la partida de la madre que desaparece de su vista.
Dice Lacan: “(…)” “…así el niño empieza a adentrarse en el sistema del discurso concreto del ambiente, reproduciendo más o menos aproximadamente en su ¡Fort! y en su ¡Da! los vocablos que recibe de él”.
Una manera de transitar el desierto hacia la recreación de la palabra como símbolo y no como imagen. Hay una falta constitutiva del sujeto, la falta en ser. Es la falta del objeto de satisfacción que pasa a la falta del objeto de amor. En la caída del objeto (a) reside justamente el nacimiento del sujeto escindido.
Qué quiere decir que está escindido? Que está dividido entre el sentido que el discurso del Otro le dio a los objetos libidinales en relación a sus necesidades, y aquello que se ha reprimido. Allí se instala un hiato. Un no sentido.
Pero cómo lo sabemos? Lacan ubica la falla del saber por donde la verdad se cuela. Algo contingente, un equívoco, un lapsus, un sueño. Lo Real: el objeto (a) causa de deseo. Aquello que se sustrae y comanda mi deseo. ¿Entonces, hay una verdad en el no sentido? Tam-poco; con la connotación de homonimia que da este significante. Hay in-completud. Falta en ser.
¿Qué resta, pues, de la relación gnoseológica en el psicoanálisis?
LA VIOLENCIA SIMBOLICA DE LA RETORICA DEL IMAGINARIO SOCIAL
Hay una inversión. Del “si pienso soy”, el psicoanálisis pasa a la lógica del “pienso donde no soy y soy donde no pienso”. Sujeto del Inconsciente. Deja de ser ¿qué?: el sentido pro-puesto por el Otro. En esta separación se juega la libertad humana. No ceder ante el propio deseo frente al deseo del Otro incluye, entonces, el aforismo freudiano: “Wo es war soll ech werden”: Allí donde el ello era, que el sujeto del Inconsciente advenga.
El silencioso lazo social establecido en el diálogo entre la mirada y el arte está expuesto a la angustia de castración. La inmediatez de la información la calma. Denuncio este acto como violencia simbólica del poder de la época, ya que sólo podemos percibir cierto bien decir del arte o de los otros o del Inconsciente.
La retórica del Imaginario asociada al uso de las letosas y a la robótica, degrada el Simbólico. El deseo resulta engorroso frente a la velocidad del ¡goza, “Tú debes” pasar al acto! de nuestro siglo.
El Simbólico queda lejos del parloteo de la retórica de las imágenes y cerca de un goce vital. Retórica desprovista aún de aquello que no se nos sustrae al pensar: la falta que nos permite la disposición al deseo del sujeto relanzado en un ¡Fort! ¡Da! infinitamente renovado. La didáctica del pensar a través del aprendizaje del filosofar, puede ejercer una suplencia simbólica al todo-imaginario al que nuestros adolescentes y niños son inmersos: el mundo virtual, nuevo ambiente de lenguaje de nuestro tiempo.
Resumen
Durante su experiencia con las letosas, en su trabajo como psicoanalista y docente, la autora se encuentra con una imagen de Internet. Esta desencadena su pensar sobre las virtudes del psicoanálisis y su convocatoria del deseo, como promotor de lo que llamará un goce vital del sujeto y sobre la eficacia de la didáctica de la filosofía para los niños y los adolescentes, en lo que significa la experiencia del pensar, hoy día, en relación al arte y la ciencia.
Palabras clave:
Deseo, Goce, Filosofía, Experiencia, Pensar
Abstract:
During an experience with the gadgets at work, in her consulting room, the author found herself with an image in the internet. That released her thoughts about the virtues of the psychoanalysis and its appealing of desire, as a promoter of what she will call a subject’s vital joy and its effectiveness of the philosophy’s didactics for the children and teenagers, in what will mean the experience of thinking, nowadays, regarding art and science.
Key words:
Desire, Joy, Philosophy, Experience, Thinking
CURRICULUM VITAE
Mgter. MARIA-ROSA (MARISA) PRONESTI
Es Master en Sociología de la Cultura y Análisis cultural, por la UNSAM, (2009). Tesis en curso.
- Especialista en la Atención y Rehabilitación de las Adicciones, Por el (CEA) Centro de Estudios Avanzados de la UBA (1988)
- Licenciada en Psicología, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (1975)
- Bachiller, por la Universidad de la SORBONNE – PARIS IV (1969)
– Ha publicado sobre Práctica Clínica y Derechos Humanos;
– sobre la Interdisciplina entre Medicina y Psicoanálisis: “Algunas consideraciones acerca del dolor”, en la Revista “Actualidad Psicológica”.
– Ha sido Conferencista en Congresos Nacionales, Regionales e Internacionales y Provinciales sobre: Género; Violencia Simbólica; Trauma y Urgencia, entre otros temas.
– Ha participado en calidad de Titular y Adherente, Alumna, Observadora, Coordinadora, Relatora y Docente en distintos eventos y seminarios sobre Cultura y Desarrollo Sustentable, Organización social, Ciudadanía y Cultura. Prevención Primaria y Roles Profesionales en el Campo de la Salud Pública.
– Ha organizado y/o coordinado Talleres con los siguientes temas: Prevención de la Violencia Social, Escolar y Familiar, Políticas Públicas, Educación Permanente de Adultos, Formación de Formadores, Derechos Humanos y Asuntos Comunitarios.
– Ha disertado sobre la competencia de la Interdisciplina entre las Ciencias Sociales, la Pedagogía y las Ciencias Políticas; la Psicología y la Psiquiatría.
-Actualmente es Psicoanalista, Docente y Directora de Clínica psicoanalítica, (Freud-Lacan), en Psi Instituto.
Cécile Tranier : “Asiles” de Erving Goffman

Études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus
ERVING GOFFMAN
Traduction de Liliane et Claude LAINÉ
Présentation, index et notes de Robert CASTEL.
LES EDITIONS DE MINUIT (1968)
Par Cécile TRANIER
Psychologue Clinicienne
« On peut se représenter une institution totalitaire comme une espèce de mer morte où apparaissent de petits îlots de vie active et séduisante. De telles activités aident sans doute le reclus à supporter l’état de tension psychologique engendré par les attaques que subit sa personnalité »1
« Ces îlots de vie active et séduisante » sont le fil rouge des observations du sociologue -ethnographe Erving Goffman, lors de son immersion au sein de l’hôpital Psychiatrique, de plus de 7.000 lits, St Elizabeth de Washington pendant l’année 1955-1956. Ses notes sont réfléchies et étayées en quatre essais réunis sous le titre d’Asiles en 1968, et seront introduites en France par Pierre Bourdieu, dans le moment de la psychiatrie alternative. Aujourd’hui son inspiration continue avec notamment le documentaliste Raymond Depardon dans
son film de 2017, « 12 jours ».
Erving Goffman est né le 11 Juin 1922 au Canada, où ses parents juifs ukrainiens avaient immigré, et est décédé le 19 Novembre 1982 aux Etats-Unis. C’est d’abord à Toronto puis à l’université de Chicago qu’il fait ses études. Il réalisera sa thèse de doctorat sur l’étude de la vie dans les îles Shetland, où il pratiquera la méthode de « l’observation participative » ou l’immersion en son objet d’étude.
C’est à la suite de son « observation participative », de 1955 à 1956 nuit et jour, puisqu’il réussira à se faire enfermer dans l’hôpital psychiatrique Ste Élizabeth, contrairement au règlement, qu’il définit l’hôpital comme une institution totalitaire2 en particulier, tout en se référant à d’autres institutions totalitaires en général comme les prisons, les casernes militaires, les navires de guerre, les internats, les couvents et autres collectivités…
Il parle alors d’«inmate » ou reclus3, dont le point d’orgue est de partager des rituels mortifères (dépouillement de tout objet personnel, dépersonnalisation, perte d’état civil, perte de gestion de ses biens, vêtements de l’institution imposés, déférence exigée, hygiène limitée, rationalisation des portions alimentaires, fouilles, palpations, châtiments corporels…) organisés par l’institution totalitaire afin d’effacer toute trace de Mot-Image-Corps intime et singulier en la personne pour le déformer en reclus au MIC prescrit à ses exigences normatives.
Le reclus vit alors une véritable schize dans ses anneaux transférentiels MIC.
Cette coupure symbolise la mort sociale, civile, psychique et parfois physique de la personne.
La survie à ce « meurtre social » pourra se faire par « l’adaptation primaire4»soit l’acceptation ou le faire semblant de l’acceptation du MIC prescrit.
Ce moins de vie ne pourra être tenu que dans un plus de vie ou « l’adaptation secondaire 5», de la vie clandestine, embryon de la vie d’après l’enfermement et réminiscence de la vie d’avant. Une géographie et une économie de la liberté vont alors émerger dans cette atmosphère d’oscillations de poussées contraires issues de l’adaptation primaire et de l’adaptation secondaire. Certains se créeront, alors, des « zones refuges » en s’enveloppant de couverture, en se réfugiant aux toilettes; d’autres des « zones franches » comme l’atelier d’art-thérapie, de menuiserie; d’autres encore accepteront l’insulinothérapie pour un peu de maternage par les infirmières; enfin certains continueront leurs activités d’avant en l’institution6 pendant que d’autres feront des petits travaux pour le personnel (ménage, lavage de voitures, garde d’enfants…) autorisant l’accès à la vie au-delà des bâtiments de réclusion.
Cette « carrière morale »7 du reclus portera les stigmates en son MIC prescrit du « couloir de la trahison » ou trompé, caché de son entourage notamment lors du diagnostic où un comportement social déviant sera rattaché à un problème organique pour justifier l’hospitalisation.
Le MIC prescrit sera donc la mise au pas (gleichschaltung) du reclus contraint mais aussi du reclus volontaire par fissuration de l’intime et vulnérabilité acquise afin d’annihiler toute sédition8 Révolte savamment étouffée dans les tensions ou oscillations des poussées contraires entre « adaptation primaire » et « adaptation secondaire ».
Ainsi l’institution totalitaire s’évertuera à déformer le vivant en inerte pour le rendre matériau malléable au moule mortifère du comportement redressé.
De nos jours, l’oscillation majeure entre « l’adaptation primaire » et « l’adaptation secondaire » Goffmanienne s’est transformée en « adaptation sécuritaire » oscillant avec « adaptation thérapeutique ».
Ces poussées contraires issues des normes du social génèrent des souffrances dans le mental des internés comme des encadrants9.
La chaire de philosophie à l’hôpital, le suivi psychothérapeutique aussi bien en hôpital qu’en pénitentiaire, la possibilité de faire des formations en détention, l’art-thérapie et l’exposition des travaux … autant d’ouvertures de l’institution au monde ne sont arrivées à résoudre cette poussée mortifère.
Ce qui fait dire au professeur BELLIVIER10, en l’article de Luc BRONNER du MONDE du 11.01.2025, que la solution du plus de vie serait dans le changement des pratiques plus que dans les moyens financiers.
Ce changement des pratiques et ses recherches sont justement proposés à l’APPS (Analyse Pratique Psycho Sociale).
Enfin, je rappellerai pour synthétiser l’ouvrage d’Erving GOFFMAN ce qu’écrivait Etienne de La Boétie :
« Pour que les hommes, tant qu’ils sont des hommes, se laissent assujettir, il faut deux choses l’une : ou qu’ils soient contraints, ou qu’ils soient trompés. »
SOURCES
OUVRAGES :
Axel Honneth La réification- Petit traité de théorie critique
-GALLIMARD PARIS 2007-
Étienne de la Boétie Discours de la servitude volontaire
-PAYOT&RIVAGES PARIS 2002-
Sigmund FREUD Psychologie des masses et analyse du moi.
-Quadrige, PUF Paris 2019
ARTICLES :
APPS Articles du blog
Hervé HUBERT Transidentité et psychanalyse: partir d’une autre base
LE MONDE Les crises aigües de la psychiatrie publique
Articles de Luc BRONNER- 11,12 Janvier 2025
FILMS :
Milos FORMAN Vol au-dessus d’un nid de coucou -1975-
Nicolas PEDUZZI État Limite – 2023-
jusqu’au 15 Mai 2026.
Raymond DEPARDON 12 jours – 2017-
1 Asiles de Erving Goffman p :115
2 Id p:41 « …comme un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d’individus, placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées.
3 Id p:41 « Reclus » :il n’existe pas en français d’équivalent du mot « inmate » employé par l’auteur pour désigner à la fois les personnes enfermées dans un hôpital psychiatrique, une prison, un couvent, une école, un navire de guerre ou de commerce, une caserne, etc. En choisissant le terme de « reclus », on a voulu mettre l’accent sur l’isolement de ces personnes dans un environnement claustral qui constitue l’aspect essentiel de leur commune situation. (N.d.T)
4 Concept Goffmanien
5 Concept Goffmanien
6 Id p:321 « Dans l’un des services, j’ai connu un horloger si bien installé dans ces fonctions que plusieurs membres du personnel aussi bien que les malades avaient recours à ses services, pour un prix environ de moitié inférieur aux tarifs pratiqués au dehors »
7 Id p:224 « La carrière morale, par conséquent le moi de chacun s’élabore dans les limites d’un système institutionnel, que ce soit un établissement social, comme un hôpital psychiatrique, ou un complexe de relations personnelles et professionnelles. Le moi semble ainsi résider dans les dispositions d’un système social donné, à l’usage des membres de ce système. En ce sens, le moi n’est pas la propriété de la personne à qui il est attribué mais relève plutôt du type de contrôle social exercé sur l’individu par lui-même et ceux qui l’entourent. »
8 « Vol au-dessus d’un nid de coucou » de Milos FORMAN (1975)
9 « État Limite » film de Nicolas PEDUZZI
10 « On aura beau arroser les établissements de moyens supplémentaires, si les pratiques ne changent pas cela n’évoluera pas » Professeur BELLIVIER
Tristan Marcel : De la performance sociale à la consumation identitaire
Étude du transfert social dans La Résistible Ascension d’Arturo Ui de Bertolt Brecht

Introduction
« Malheureux le pays qui n’a pas de héros ! » s’exclame Andrea, disciple de Galilée, à la scène 13 de La Vie de Galilée (Brecht, 1938-1339), ce à quoi son maître répondra : « Malheureux les pays qui ont besoin d’un héros ! ». Deux ans plus tard, Bertold Brecht semble proposer une illustration de cet aphorisme par La Résistible Ascension d’Arturo Ui. Jamais ni publiée ni jouée du vivant de son auteur, la pièce relate l’ascension d’un gangster, Arturo Ui, qui prend le pouvoir sur le trust du Chou de la ville de Chicago avant de l’étendre de manière tyrannique jusqu’à la ville voisine de Cicero.
Rédigée durant l’exil de l’auteur et alors qu’il est sur le point de rejoindre les États-Unis, cette pièce a longtemps été lue comme une parabole historique de la montée du nazisme : les noms des personnages (Giri pour Goering ; Dogsborough, Hindenburg ; Givola, Goebbels ; Roma, Röhm ; Dullfeet, Dollfuss ; etc.) et les panneaux historiques en fin de scènes soutiennent évidemment cette lecture. En effet, « Arturo Ui a été conçu dans un contexte politique précis à des fins politiques précises, sous le signe de l’urgence. À un moment donné, Brecht a même cru pouvoir monter le spectacle aux États-Unis, qu’il s’agissait alors d’entraîner dans la guerre. Brecht cherche à lancer aux démocraties occidentales un avertissement lucide » (Ivernel, 1970, p. 61).
Néanmoins, au-delà de cette dimension politique, la pièce illustre une problématique universelle et plus que jamais contemporaine : toute société totalitaire inocule en l’individu un conflit intrapsychique entre identité authentique et performance sociale, autrement dit un conflit issu du transfert des structures sociales dans le mental. À l’heure où notre société semble s’engager dans une course folle vers l’hégémonie des valeurs économiques, de plus en plus détachées de toute valeur humaine, à l’heure des cryptomonnaies et du transhumanisme, le théâtre épique de Brecht, plus que jamais, vient nous rappeler à ce qui nous échappe. Nous proposons donc d’interroger la façon dont cette pièce analyse la consumation de l’être dans la performance sociale.
I. La distanciation brechtienne, outil critique de la performance sociale
Déjà prônée par Diderot dans Le Paradoxe du Comédien, la distanciation est le procédé par lequel Brecht s’éloigne de la tradition de l’illusion théâtrale héritée de la poétique d’Aristote, pour engager une réflexion critique chez le spectateur. Concrètement, la distanciation cherche à révéler les rouages cachés de la réalité représentée en renversant la position du spectateur de la passivité à l’activité. Par des procédés variés qui visent essentiellement à la rupture de l’illusion théâtrale, la distanciation invite le spectateur à considérer d’un œil critique les événements qui se déroulent devant lui. Dans La Résistible Ascension d’Arturo Ui, le prologue brise d’emblée le quatrième mur par l’adresse directe au public qui établit l’espace scène-salle comme un espace commun. Aussi, tout au long de la pièce, des panneaux explicitent le lien entre l’action dramatique et la réalité historique. Ces traits d’union entre l’action dramatique et la réalité historique objectivent ainsi la machinerie théâtrale : tout est conçu pour rappeler au spectateur qu’il est témoin d’une représentation, d’une construction artistique destinée à faire passer un message clairement lisible.
Ainsi, les acteurs jouent avec la transparence de leur art : ils sont invités à souligner l’artifice de leur diction, se détacher de leurs personnages, parfois même à en parler à la troisième personne. Un seul comédien peut incarner plusieurs rôles, simultanément ou successivement, brouillant les frontières de l’identité scénique. Le gestus brechtien, en prônant la distance entre l’acteur et son rôle, interdit au spectateur de toute identification aux personnages. Il n’est pas question de catharsis, ici : les personnages sont des types sociaux plutôt que des héros. La pièce les réduit à des caricatures grotesques, dénuées à la fois d’idéalisme et de réalisme. Ainsi, Arturo Ui, dans sa quête de pouvoir, n’est qu’une figure déshumanisée, incarnant non pas un homme mais un rôle, celui du dictateur en devenir.
Cette distanciation a une valeur universelle et vaut pour métaphore du transfert social. Elle révèle en effet comment les individus adoptent des comportements performatifs en réponse aux attentes sociales, souvent à l’insu du faire et à l’origine de souffrance psychique. En effet, Marx l’a écrit dans la VIe Thèse sur Feuerbach : « L’essence humaine n’est pas une abstraction résidant dans l’individu pris isolément. Dans la réalité, elle est l’ensemble des rapports sociaux » (Marx traduit et cité par Caveing, 1996, p. 85). Autrement dit, les logiques sociales qui précèdent l’identité individuelle « tiennent sous leur empire souverain le développement personnel des individus, leur déformation ou leur épanouissement » (Caveing, 1996, p. 89). Les personnages de Brecht n’agissent pas par libre arbitre ou authenticité, mais par nécessité stratégique consciente ou inconsciente : l’apprentissage des techniques de diction et de maintien par Arturo Ui (scène 6) en est un exemple flagrant. Dans cette scène, le dictateur en devenir cherche à acquérir auprès d’un Comédien des techniques de diction et de maintien (scène 6, p. 59) :
Ça veut dire quoi naturel ? Personne aujourd’hui
N’est naturel. Quand je marche, je souhaite qu’on
Remarque je marche.
Il s’agit moins ici d’une quête identitaire que de la construction d’une image destinée à convaincre l’Autre social de sa propre existence. Chez Arturo Ui, la consumation identitaire est telle que pour exister, il doit performer son existence, ce qui n’est pas sans rappeler le fonctionnement de grands dirigeants contemporains. Dans ce paradigme, l’homme se doit d’être unilatéral, lisible par tous, autrement dit héroïque. Or, Francis Combes le rappelle, « il n’est pas de héros humains » (Combes, 2025) car l’humain est avant tout fait de poussées contraires. Dans La Résistible Ascension d’Arturo Ui, le drame de l’homme, ce qui l’éloigne de son humanité même, est de devoir revêtir cette carapace performative. Bertold Brecht se place ainsi dans l’héritage de Molière en donnant à voir sur scène une société des masques, des avatars où le faux-self identifié par Winnicott (1965, p. 218) devient le mode de fonctionnement privilégié. Une logique de cercle vicieux s’installe alors : plus son identité est consumée, plus l’homme a besoin de la performer et plus il la performe, plus elle se consume.
Consumation
identitaire

Performance
sociale
II. Capitalisme et réification
Aussi, la pièce s’inscrit dans une critique marxiste de la société capitaliste, où les relations sociales sont réduites à des échanges économiques : « c’est la découverte que les rapports de production entre les hommes sont transformés par le capitalisme en rapports abstraits entre les choses, qui permet de comprendre le caractère apparemment inexorable, naturel, objectif des lois économiques du capitalisme » (Caveing, 1996, p. 91). Ce phénomène de réification, dénoncé par Marx et repris par Brecht, transforme les individus en marchandises, en produits, valorisés non pour ce qu’ils sont mais pour leur utilité dans le système. Autrement dit, la valeur de l’homme est réduite à sa valeur marchande : hier force de travail, aujourd’hui « temps de cerveau humain disponible » pour reprendre l’expression de Patrick Le Lay. Dans La Résistible Ascension d’Arturo Ui, les personnages ne cherchent pas à incarner une essence humaine : ils performent dans le but d’accumuler pouvoir et richesse, chacun devenant un simple rouage dans la machine capitaliste. C’est ce dont se rend compte, mais trop tard, le vieux Dogsborough, au moment où il rédige son testament (scène 9A, p. 86 et 87) :
Ainsi, moi, l’honnête Dogsborough
J’ai consenti à tout ce que ce gang sanglant
A tramé et commis, après que j’ai traversé
Quatre-vingts hivers avec dignité. O Ciel!
J’entends ceux qui m’ont connu avant dire
Que je ne sais rien, et que si je savais
Jamais je ne tolèrerais. Mais je sais tout.
Sais qui a allumé l’entrepôt de Hook.
Sais qui a traîné et drogué le pauvre Fish.
Sais que Roma était chez Sheet au moment de
Sa mort sanglante, le billet de bateau en poche.
Sais que Giri a descendu ce Bowl
Ce midi-là devant l’hôtel de ville, parce qu’il
En savait trop sur l’honnête Dogsborough.
Sais qu’il a abattu Hook, et l’ai vu avec le chapeau de Hook.
Sais qu’il y a cinq meurtres de Givola, que je
Mentionne en annexe, et sais tout sur Ui et que lui
Savait tout, de la mort de Sheet et Bowl aux
Meurtres de Givola et tout sur l’incendie.
Tout ça je le savais, et tout ça je l’ai
Toléré, moi, votre honnête Dogsborough, par soif
De richesse et par peur que vous doutiez de moi.
Wolfgang Kayser, critique littéraire allemand, définit le réel décrit par Brecht comme « un univers devenu étranger à lui-même, aliéné, manquant de tout repère pour s’orienter » (Kayser cité par Ivernel, 1970, p. 56). Ainsi peut se comprendre l’hébétude des personnages à l’ouverture de la pièce : le cri de Flake « Sale époque ! » en est la première réplique et Burberry se demande « Morale, où es-tu en temps de crise ? » (Scène 1, p.10). Ainsi dépouillés de leur identité singulière, de leurs valeurs, leur vie délestée de son sens, leur récit dérobé par celui de la propagande, les individus sont réduits à leur fonction de rouage dans le système économique en place.
Cette réification au profit du système est particulièrement illustrée par le dialogue d’Arturo Ui avec la veuve Dullfeet, où le tyran, en tant qu’incarnation du système, abandonne toute prétention à une interaction humaine authentique (scène 13, p.124) :
Une très amère expérience m’enseigne de ne pas
Parler ici d’être humain à être humain, mais
D’homme d’influence à femme propriétaire
D’une société d’import.
Cet extrait témoigne de la subsumation des relations interpersonnelles par des logiques économiques, où la performance remplace l’authenticité. Dans son entreprise de chosification poussée jusqu’au paroxysme, l’Angkar (Parti communiste du Kampuchéa, « Khmer rouge ») avait choisi pour slogan « Tu nous seras plus utile mort que vivant car ton engrais fertilisera les terres » (Locard, 1996). De même, dans La Résistible Ascension d’Arturo Ui, les identités des personnages se réduisent à des rôles endossés pour répondre à des impératifs externes. Finalement, les personnages de Brecht illustrent avec le concept d’« homme système » proposé par Françoise Sironi à partir de sa rencontre avec un tortionnaire Khmer Rouge : « L’homme système est une coconstruction d’identité de nature performative. C’est une technique de construction de soi. […] À défaut de pouvoir vivre son identité en construction, difficile, multiple ou trop compliquée, on la performe, conformément à un modèle et à une attente » (Sironi, 2017a, p. 159).
Enfin, le titre de la pièce, insistant sur le caractère résistible de l’ascension d’Arturo Ui, souligne que ce processus est le produit d’un contexte social : ni une fatalité, ni un destin, mais un système logique dont chaque membre est à la fois agent, produit et effet, pour reprendre le triptyque isolé par le docteur Hervé Hubert. Le système totalitaire décrit par Brecht pousse ainsi les individus à performer des identités adaptées aux structures dominantes, au détriment de leur être authentique : ce processus est d’autant plus vicieux et délétère qu’il se fait bien souvent à l’insu du faire. La performance remplace l’existence malgré l’être. L’homme-système, que nous sommes tous à un certain degré d’intensité, ne se rend pas compte qu’il passe à côté de ce qu’il a et qui s’appelle : la vie. Dès la scène 1, Mulberry nous prévient (p. 11) :
Ne pas être mort ne signifie pas : vivre.
III. Une illustration clinique : le parcours de vie de Duch, enfant cambodgien devenu tortionnaire.
L’itinéraire de Duch, présenté par Françoise Sironi dans Comment devient-on tortionnaire ? (Sironi, 2017b), nous semble illustrer d’une manière paroxystique, comment la performance sociale consume l’identité. Son parcours est celui d’un enfant cambodgien d’origine chinoise, né en 1942 dans la pauvreté et l’ostracisme, marqué dès son plus jeune âge par un système social structuré autour de la subordination et de l’humiliation. Enfant d’une minorité chinoise méprisée au Cambodge, il grandit dans un environnement où la dette (celle de son père), l’infériorisation et l’effacement identitaire sont omniprésents. L’école, bien que lui offrant une échappatoire et un espace de valorisation unique, lui transmet une éducation stoïcienne, qui prône la rigueur et le dépassement de soi. Cette éducation façonne un esprit en quête d’ordre et de reconnaissance.
Dès l’adolescence, Duch intériorise un profond clivage issu du social : en apparence, il s’adapte parfaitement aux codes du lycée d’élite où il étudie, mais intérieurement, il nourrit un ressentiment latent contre les structures qui le maintiennent dans une position subalterne. L’événement déclencheur de son basculement idéologique survient lorsqu’il assiste au triomphe d’un dignitaire chinois en visite officielle : il y voit la promesse d’une revanche sociale et identitaire possible, une revalorisation de son existence et de celle de son père. Dès lors, le communisme devient pour lui un cadre explicatif et une proposition de réparation collective et individuelle.
Après quelques échecs professionnels et sentimentaux, Duch trouve dans les textes marxistes clandestins une alternative à son décalage identitaire. Son engagement politique s’intensifie après un passage en prison, où la peur de la mort achève de transformer son rapport au monde. Lorsqu’il rejoint les Khmers rouges, Duch met son obsession de l’ordre et de l’efficacité au service du système, trouvant dans l’organisation révolutionnaire un cadre qui lui procure reconnaissance et légitimité. Mais, en l’occurrence, il s’agit d’un système totalitaire qui vient en remplacer un autre. Comme celui décrit par Bertold Brecht, ce nouveau système achève de consumer l’identité singulière de Dutch. La performance sociale atteint chez lui son apogée : il devient un exécutant zélé, un organisateur efficace, non mu par une cruauté essentielle mais par un besoin viscéral d’être intégré et valorisé par le corps social. Sa loyauté totale, nourrie par le désir d’affiliation, fait de lui un élément clé du dispositif répressif des Khmers rouges.
Sa promotion à la direction du centre de torture et de mort S-21 parachève le transfert social : il n’est plus un individu avec des doutes et des contradictions, articulé par les poussées contraires, mais le rouage fonctionnel d’une machine totalitaire. L’éducation stoïcienne de son enfance, qui prônait le dépassement de soi par la discipline, s’articule parfaitement avec l’idéologie khmère rouge, qui exige d’éteindre son cœur (« Éteignez votre cœur » était en effet l’une des maximes de l’Angkar). Duch exécute, rationalise, organise, non par plaisir mais parce que le système exige performance et efficacité. Son besoin de reconnaissance par le système social devient le moteur principal de son existence, au point qu’il se marie selon les règles du parti, validant ainsi son appartenance totale à la structure.
Ainsi, l’identité singulière de Duch s’est-elle érodée, effacée au fil du temps, remplacée par une volonté inébranlable d’être un parfait serviteur du régime. À l’instar des drames des personnages brechtiens, l’histoire de Duch illustre comment un individu peut être modelé par des structures sociales qui s’insinuent dans son psychisme, le poussant, à son insu, à troquer son humanité contre une fonction, un rôle, une place dans un système qui l’a d’abord rejeté avant de l’absorber entièrement.
Conclusion
Par La Résistible Ascension d’Arturo Ui, Brecht dépasse le seul réquisitoire contre le nazisme pour offrir une critique systémique de tous les totalitarismes dans lesquels la performance remplace l’existence. Le théâtre épique, par ses procédés de distanciation et de rupture de l’illusion théâtrale, donne à voir les effets du transfert social sur l’identité individuelle. Cette réflexion, qui anticipe les débats contemporains sur la performativité et la marchandisation des relations humaines, fait de l’œuvre de Brecht une source précieuse pour comprendre les dynamiques identitaires dans un monde dominé par un système hégémonique. Sans doute, la glorification masculo-capitaliste célébrée lors de la dernière investiture de Donald Trump est-elle la plus récente illustration de cette logique qui contraint les individus à performer plutôt qu’à être. La pièce nous invite à résister à cette logique, en réaffirmant la possibilité d’une identité authentique et d’une transformation sociale (Epilogue, p. 135) :
Apprenez donc à voir au lieu de rester béats
Et agissez au lieu de parler encore et encore.
Avant de se clore sur l’avertissement désormais célèbre :
Le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde.
Tristan Marcel
Professeur agrégé de Lettres Modernes,
Stagiaire psychologue à l’APPS,
Université Paris Nanterre
Bibliographie :
Caveing, M. (1969). « Le marxisme et la personnalité humaine ». Raison présente, 11, 85-108
Combes, F. (2025). « Du droit à la différence au combat pour l’égalité ». Conférence donnée à l’APPS, mardi 04 février 2025. Recueil inédit, Centre Georges Politzer, Paris.
Brecht, B. (1941). La Résistible Ascension d’Arturo Ui (H. Mauler et R Zahnd Trad.). L’Arche (2012).
Brecht, B. (1938-39). La Vie de Galilée (E. Recoing Trad.). L’Arche (1990).
Diderot, D. (1830). Paradoxe sur le comédien. Flammarion (2000).
Philippe Ivernel, P. (1970). « Quatre mises en scène d’Arturo Ui ». Les Voies de la création théâtrale, 2, 55-109.
Locard, H. (1996). Le « Petit livre rouge » de Pol Pot ou les paroles de l’Angkar. L’Harmattan.
Sironi, F. (2017b). « La fabrication de l’homme nouveau Khmer rouge et djihadiste Etude comparée ». L’autre, 18 (2), 153-164.
Sironi, F. (2017b). Comment devient-on tortionnaire ? La Découverte.
Winnicott, D. W. (1965). Processus de maturation chez l’enfant : développement affectif et environnement (J. Kalmanovitch, Trad.). Payot (1970).
Illustration :
Bacon, F. (1969). Three Studies of Lucian Freud. Collection privée.
Dans ce triptyque, Francis Bacon peint son ami, le peintre Lucian Freud, petit-fils de Sigmund Freud. On y voit un homme, le visage et le corps tors, dont la liberté de mouvement semble restreinte par un cadre à la géométrie stricte. La composition donne à voir toute la tension entre identité individuelle et environnement social. Ironie de l’histoire, ce tableau, le plus cher jamais vendu aux enchères, symbole s’il en est des logiques capitalistes, a complétement brûlé avec la maison de son propriétaire, Anthony Hopkins, lors des incendies de Los Angeles en janvier 2025. L’on parlait de consumation ?